Deux ou trois choses que « APPRENDRE, SI PAR BONHEUR », le roman de Becky Chambers, parlant de demain, nous dit sur aujourd’hui…
« Dis-moi quel film tu regardes, je te dirai quel avenir tu te prépares », parole de prospectiviste !
Titre original : To Be Taught, If Fortunate (Hodder & Stoughton, 2019)
Auteur : Becky Chambers
Pages : 140
Editeur : L’Atlante, 2020
Chronique d’analyse prospectiviste conçue en collaboration avec Space’ibles, l’Observatoire Français de Prospective Spatiale, initiative du CNES.
Apprendre, si par bonheur est un court roman de Becky Chambers, une jeune autrice américaine qui inscrit son œuvre dans une forme de Nouvelle vague de la science-fiction. Ces dernières années, au regard des enjeux globaux (climatiques, démographiques, sanitaires…) auxquels l’Humanité va devoir — ou commence à — faire face et de l’évolution des modes de pensées qui, désormais, donnent la parole aux minorités, il a souvent été reproché à la science-fiction de se complaire dans la dystopie — le meilleur du pire de l’avenir de l’Humanité — ou de reproduire des schémas comportementaux individuels ou collectifs désormais jugés inappropriés ; on peut penser à l’attitude colonisatrice d’une Humanité se répandant au cœur de la Galaxie.
De son côté Apprendre, si par bonheur prend la forme du rapport d’exploration de la mission Lawki 6. Ce rapport date des années 2170 (aucune date précise n’est indiquée dans le roman, flou à l’image de la dérive morale dans laquelle se trouve l’équipage du Merian) et est rédigé à l’issue de l’exploration de quatre planètes d’un système stellaire fictif nommé Zhenyi et situé à 14 années-lumières de la Terre. Sous les mots de l’ingénieure de vol du vaisseau Merian, le lecteur suit les actes nécessairement audacieux, mais teintés de prudence et d’humilité, des quatre membres d’équipage. Et, Apprendre, si par bonheur propose au lecteur un nouveau regard sur l’exploration spatiale d’autant plus étonnant que, à cause de la distance et d’une perte de contact avec le contrôle de mission terrestre, ce rapport est envoyé comme une bouteille à la mer… Quant au titre du roman, il trouve son origine dans la déclaration de bonnes intentions de l’Humanité adressée à d’éventuelles intelligences extraterrestres, déclaration enregistrée sur deux versions du Golden Record, chacune voyageant, depuis 1977, à bord des deux sondes Voyager.
LA TERRE ET L’ESPACE
Mais, revenons sur les postulats à la base de ce roman. Peu de choses sont dites de cette Terre de demain. Des évolutions géopolitiques sont évoquées et il semble qu’il aura fallu près d’un demi siècle à l’Humanité pour se sortir des chocs issus des dérèglements climatiques qui se présentent comme notre avenir immédiat. Mais, en définitive, la crise a-t-elle été résolue ? Le roman ne donne pas vraiment d’indices… Juste quelques constats : tant que le calme ne fut pas assuré dans la demeure Terre, les portes de l’Espace sont restées closes.
Une autre idée est sous-entendue et distillée dans le roman : au nom d’une écologie propre à assurer la (sur)vie de l’Humanité, le droit de libre entreprise — spatiale — pourrait avoir été aboli, à moins que ces élans ne se soient éteints d’eux-mêmes. Mais, au profit de quoi ? Quelles sont la ou les valeurs de cette Humanité future ? Chacun peut les imaginer à sa manière à la lecture du roman. Une chose est sûre : l’esprit de curiosité de l’Humanité reste vivace et, après un demi-siècle de pause, la dimension spatiale de cette curiosité acquiert à nouveau le droit de cité, et ce jusque dans les formes les plus folles de notre point de vue contemporain : aller à la découverte de mondes au-delà de notre système solaire grâce à un financement collaboratif, à un crowdfunding planétaire !
L’EXPLORATION SPATIALE
Au-delà de la belle intention de voir l’exploration spatiale être pilotée et financée à l’échelle mondiale par les dons d’une armée invisible d’enthousiastes — peu importe la taille de leurs dons —, Becky Chambers se fait porte-drapeau d’une pensée qui se veut bienveillante et inclusive. Tout en prenant acte de l’incurable curiosité de l’Humanité, elle développe, en conséquence de tous ces paramètres, une nouvelle manière d’engager l’aventure spatiale humaine, une manière acceptable par l’époque du récit, le XXIIème siècle, mais qui n’en interroge pas moins nos ambitions contemporaines.
Ce qui, ici, est nommé de manière espiègle crowdfunding, prend la forme du GAO, Groupement Astronautique Ouvert, une forme de science ouverte, qualifiée dans le roman de « apolitique, internationale, sans but lucratif », une organisation suffisamment puissante pour soutenir une industrie aérospatiale dédiée à l’exploration de systèmes planétaires extra-solaires. Cette exploration prend la forme des missions d’exploration interstellaire nommées Lawki. Et le roman nous invite à suivre les aventures de la sixième de ces missions au travers des mots d’Ariadne, la pilote du vaisseau Merian.
EXOPLANÈTES ET VIE EXTRATERRESTRE
C’est avec elle que l’on découvre un autre postulat du roman. Il s’agit de l’étonnant constat de la profusion de la vie dans les systèmes stellaires à proximité de la Terre.
Si on considère une sphère de 30 années-lumière de rayon centrée sur notre soleil, on ne recense pas moins de 540 astres répartis dans 339 systèmes stellaires. Et, en fonction de l’actuel catalogue de la faune des exoplanètes confirmées, on estime que cette même sphère devrait également contenir environ 600 planètes. De quoi susciter quelques embarras au moment de choisir une éventuelle destination pour une mission humaine interstellaire! Et parce que la vie extraterrestre est la norme dans le roman, la mission de l’équipage du Merian consiste en l’exploration de quatre planètes du système de Zhenyi, chacune d’entre elles abritant des formes de vie variées (depuis des organismes monocellulaires jusqu’à des formes de vie multicellulaires, plus complexes) ou bien à différents stades d’évolution.
Mais comment, depuis la Terre, fait-on pour déterminer si une étoile possède une ou plusieurs planètes en orbite ?
C’est en 1995 que les astronomes genevois Michel Mayor et Didier Queloz, de l’Observatoire de Haute-Provence, ont annoncé la détection de la première exoplanète. Pour y arriver, ils avaient utilisé la méthode des vitesses radiales. Il s’agit de détecter d’infimes changements de la longueur d’onde de la lumière émise par une étoile dont la vitesse relative est altérée par une planète en orbite autour d’elle. Il existe d’autres méthodes de détection des exoplanètes, par exemple la méthode des transits : là, on cherche à détecter la diminution de la luminosité d’une étoile quand une de ses planètes passe entre elle et l’observateur sur Terre. On peut aussi utiliser l’astrométrie : il s’agit, ici, de détecter les oscillations d’une étoile sous l’influence d’une planète qui gravite autour d’elle. Viennent enfin les microlentilles gravitationnelles : là, on vérifie la symétrie de la déformation de l’espace-temps provoquée par une étoile candidate. En effet, la présence d’une exoplanète autour de cette étoile candidate provoque un défaut de symétrie de la lentille gravitationnelle : l’image d’un corps stellaire lointain (étoile, galaxie…) qui se situerait dans l’alignement entre l’observateur et l’étoile étudiée serait déformée. En dernier lieu, dans l’état actuel des connaissances, reste l’observation directe. Elle se fait et se fera avec des télescopes adaptés à cette tâche, le télescope spatial James Webb étant le premier à être capable de cette prouesse.
En 2023, toutes ces techniques ont permis d’identifier plus de 5 300 exoplanètes. Et d’autres technologies sont encore à envisager : ce sont des télescopes virtuels faits de l’addition des capacités de plusieurs observatoires — on obtient ainsi une lentille virtuelle de grand diamètre —, sur Terre ; ou bien sur la Lune : la lentille virtuelle serait sur la Lune plus petite que celle constituée à l’échelle de la Terre, mais en l’absence d’atmosphère lunaire, la résolution des images pourrait être meilleure. Ou encore en utilisant le système Terre-Lune : la lentille aurait alors le diamètre du rayon d’orbite de notre satellite autour de la Terre, soit environ 300 000 kilomètres. De quoi voir loin.
A essayer d’envisager la vie extraterrestre, il faut ensuite se poser la question de la nature des exoplanètes. Sont-elles rocheuses ou gazeuses ? A ce sujet, les recherches actuelles en exobiologie semblent s’accorder sur l’importance d’un sol pour permettre à l’évolution de déployer tous ses potentiels. Ainsi, une planète tellurique candidate à la vie doit être suffisamment massive pour que sa gravité retienne une atmosphère ; a contrario, une planète trop massive pourrait s’avérer impropre à la vie, car sa forte gravité retiendrait les gaz légers, comme l’hélium, qui ne sont pas compatibles avec la vie telle qu’on la connaît sur Terre. Ou encore : ces planètes abritent-elles de l’eau? Quand on observe une étoile, même de loin, elle nous dit beaucoup d’elle-même et des conditions géophysiques à sa proximité. En effet, toute étoile est entourée d’une sphère virtuelle, sa « zone habitable », dans laquelle une planète en orbite peut receler de l’eau à l’état liquide. Trop proche de son étoile, la planète verrait ses réserves d’eau se vaporiser. Trop éloignée et c’est la glace qui y règne… Mais si, comme le suggère le roman, la profusion de la vie extraterrestre est la norme, c’est peut-être aussi que l’évolution sait contourner ces critères de gravité ou d’eau liquide, la vie prenant alors des formes étonnantes au-delà de notre référentiel du Vivant sur Terre.
Une fois une exoplanète identifiée, le but ultime est d’en isoler la lumière. Faisant cela, on pourra y chercher, par spectroscopie, les marqueurs chimiques de la vie, en tout cas de celle que l’on connaît sur Terre, c’est-à-dire des molécules telles que la phosphine, un biomarqueur récemment identifié dans l’atmosphère de Vénus (… qui, a priori, ne porte pourtant pas la vie !)
Dans le roman de Becky Chambers, les études exobiologiques menées par l’équipage du Merian nous donnent de beaux échantillons des chemins alternatifs ou bien des capacités d’adaptation empruntés par le Vivant, chacune des quatre planètes du système Zhenyi proposant des particularités et un bestiaire qui lui est propre, sans jamais atteindre cependant une forme de vie évoluée :
- Aecor, planète à la surface gelée (pensez à Europe ou Ganymède, deux des lunes glacées de Jupiter, que la sonde européenne Juice va étudier), mais pourtant eldorado scientifique, foisonnant d’une vie sous-marine féérique, que l’équipage va s’employer à cataloguer et classifier par analogie avec le Vivant sur Terre ou bien en identifiant de nouveaux embranchements zoologiques ;
- Mirabilis, version massive de notre Terre, où l’équipage est confronté à un règne végétal déconcertant (chimiosynthèse, feuillages noirs, formes géométriques spiralées) et à l’altérité dérangeante de la faune locale, résultant de multiples évolutions des vertébrés ;
- Opera, planète océan tempétueuse parsemée de rares îlots aux résonances de déluge biblique et de montée du niveau de la mer sous l’effet du changement climatique ; pensez à Kamino dans l’épisode 2 de la saga Star Wars. L’omniprésence de l’eau s’y avère paradoxalement décevante en matière de Vivant, avec une monotonie peut-être trompeuse ;
- Votum, quatrième planète explorée, en rotation synchrone (qui présente à son soleil toujours la même face), sans cycle jour-nuit, candidate à un Vivant éteint ou jamais apparu. Dans les profondeurs de canyons ou dans des grottes, l’équipage y trouve pourtant de l’eau et quelques micro-organismes dont la surprenante biochimie semble découvrir à l’équipage quelque profond mystère de la Vie.
L’HUMAIN ET L’EXPLORATION SPATIALE
Face à ce Vivant protéiforme, la lecture d’Apprendre, si par bonheur interroge quant à l’ingénierie génétique qui permet aux explorateurs d’acquérir des capacités physiques adaptées aux mondes sur lesquels ils se rendent. C’est la somaformation — du grec soma : corps. Il s’agit de lentes modifications des corps humains réalisées afin de leur conférer les moyens de, par exemple, résister à la forte gravité d’une super-Terre, à des doses de radiation plus élevées ou encore de voir et d’être mieux vu dans la pénombre d’une planète éloignée de son étoile… On nous dit que les périodes d’hibernation en torpeur sont mises à profit pour accomplir ces modifications génétiques des corps parfaitement réversibles. Mais alors, n’est-ce pas ainsi une forme d’augmentation technologique des humains qui est, là, en fait entérinée ? Le respect quasi-religieux des formes de vie et environnements visités n’est-il pas contradictoire d’une telle remise en cause de l’humain ? Ne sommes-nous pas par ces modifications, au contact de la pluralité des formes de vie extraterrestre et au nom de l’exploration habitée, entrés là dans une forme de post-humanité dont le terrien, avec ses caractéristiques physiques, n’est qu’un représentant ? Et, finalement, Becky Chambers ne ferait-elle pas le jeu des Transhumanistes et autres techno-enthousiastes, à son corps défendant, en envisageant ces modifications génétiques même réversibles ?
Un autre aspect humain de l’aventure à laquelle Becky Chambers nous convie est l’engagement personnel et la dimension sacrificielle requis par les missions d’exploration lointaine telle qu’évoquée dans le roman. Même si, dans cet avenir, le retour sur Terre semble être la règle. Néanmoins, du fait de la durée de mission — environ 80 années, période principalement passée en état d’hibernation —, il faut intégrer à la mission le facteur de la séparation des astronautes avec leurs proches. Cette séparation est symboliquement marquée par une fête publique suivie d’une journée d’intimité familiale. De fait, c’est un adieu définitif !
ÉTHIQUE DE L’EXPLORATION SPATIALE
Dans Apprendre, si par bonheur, l’exploration exoplanétaire, la mission du Merian, a tout de l’observation scientifique naturaliste et aucune visée colonisatrice ou conquérante. Respect, humilité et prudence presque sacrés gouvernent même largement les décisions et actions des membres d’équipage. En particulier, les humains ne doivent en aucun cas impacter les environnements qu’ils étudient. A ce sujet, un épisode du roman est édifiant : un petit animal extraterrestre se retrouve, en dépit des précautions prises, prisonnier dans le laboratoire humain et sa nécessaire éradication — pour qu’il n’aille pas contaminer son environnement et ses congénères après avoir été en contact avec l’environnement humain — provoque au sein de l’équipage humain des réactions de très grande détresse.
On peut juger cette éthique — et les réactions de l’équipage — quelque peu excessives ou irréalistes, en particulier au regard des difficultés et périls de leur mission. Cette grande humilité est-elle héritée d’une nouvelle éthique liée aux problèmes environnementaux sur Terre ? Est-elle un des traits de caractère de l’Humanité future ?
À la fin du roman, l’équipage est arrivé au terme de sa mission – la visite et l’exploration des quatre corps célestes du système stellaire Zhenyi – et la Terre est devenue mystérieusement silencieuse ; Ariadne et ses compagnons doivent prendre une dernière décision qui peut interroger notre présent : retourner vers la Terre, comme prévu par la mission (mais cette dernière existe-t-elle encore, s’intéresse-t-elle encore à l’exploration ?) ou bien continuer une exploration scientifique, une aventure de connaissance vertigineuse et révolutionnaire? (toutes les données ont été envoyées vers cette Terre dont l’équipage du Merian est peut-être les derniers représentants)
L’équipage décide alors de ne pas agir de son propre chef et de remettre son destin entre les mains de cette lointaine Terre en envoyant un message, une bouteille à la mer à destination de son port d’attache, lui demandant son arbitrage ainsi que la prochaine étape de sa mission. Du fait de la distance entre Zhenyi et la Terre, l’attente durera au moins 28 ans — Zhenyi se trouve à 14 années-lumière de la Terre — durée que les membres d’équipage passeront en torpeur, la technologie d’hibernation utilisée à bord du Merian… jusqu’à réception d’une réponse. Mais la Terre est-elle encore en capacité de leur répondre ?
On peut voir dans ce dénouement les prémices de cette émancipation (classique en science-fiction) d’un équipage autonome, en mission spatiale lointaine, dont la communauté d’intérêts avec les terriens se dissout lentement. Cependant, dans Apprendre, si par bonheur, le pas n’est pas franchi et l’équipage de scientifiques s’en remet à la décision du GAO et à l’éthique d’une Humanité située à plusieurs années-lumière de l’action.
On peut s’étonner de ce comportement. Il n’est pas non plus interdit de prendre le contre-pied de cette attitude et de s’interroger sur l’absence d’autonomie qui semble être imposée à l’équipage pendant sa mission. Dans une galaxie qui se révèlerait être pleine du Vivant, il est évident que les actions d’un équipage d’exploration devraient être mûrement pesées et validées, ne serait-ce parce que, si le Vivant s’avère commun, l’intelligence extraterrestre sera sûrement en embuscade. Cependant, entre ces deux extrêmes — humilité excessive et liberté d’action réduite d’une part et colonisation maladroite ou irréfléchie d’autre part —, il y a sûrement une juste mesure plus réaliste à trouver.
Un autre mystère tourne autour d’Apprendre, si par bonheur qui selon l’autrice est le récit d’une aventure liée à la connaissance. Ici, point de colonisation — « rien à vendre », « rien d’utile », « aucune planète qu’on puisse coloniser facilement ou sans dilemme moral » —, mais une aventure seulement humaine. Et tellement humaine qu’à l’heure de l’émergence des algorithmes génératifs— appelés à tort Intelligences artificielles — dans notre quotidien, qui pourrait bien précéder l’émergence d’une nouvelle génération de robots visibles au quotidien, il n’est jamais fait mention d’IA et de robotique dans le roman. Aucune machine d’assistance aux côtés des humains, pas plus d’intelligence artificielle qui pourrait assister les humains dans le catalogage des différents bestiaires qu’ils croisent… L’auteur fait dire à sa narratrice que l’IA ne peut pas s’occuper d’exploration car elle ne serait pas capable d’agir correctement dans des situations inédites, auxquelles aucun apprentissage préalable n’a pu la préparer. Alors, point de TARS ou de CASE qui, dans le film Interstellar accompagne les humains… Est-ce une des conséquences non dites de l’éthique de ce monde à venir ? Est-ce l’éthique de l’auteur qui parle ? La lecture du roman n’en dira rien…
CONCLUSION
Comme quoi, les modalités des aventures spatiales de l’Humanité au-delà du système solaire sont loin, très loin d’être établies. Elles provoqueront sûrement bien des débats éthiques et demanderont la création de bien des procédures techniques et réglementaires. Faudra-t-il, un jour, créer une charte éthique ou des accords internationaux autour de l’exploration spatiale et de l’observation du vivant extraterrestre ? Tout cela sans même parler des procédures de rencontre avec une véritable intelligence extraterrestre, une rencontre du troisième type qui dans le roman n’est pas envisagée… En attendant, les questionnements suggérés dans Apprendre, si par bonheur sont à prendre en compte : quel est le sens profond de l’exploration spatiale lointaine, entre sciences (la thèse du roman) et potentielle exploitation de l’Espace ? Quelles technologies rendront l’Humain capable de tels voyages ? Quelles formes de vie autres pourrait-elle rencontrer et que lui apprendraient-elles sur lui-même ? Quelles problématiques éthiques se poseront aux équipages humains ? Va-t-on vers un effondrement, même partiel, des ambitions scientifiques et spatiales de l’Humanité du fait des enjeux climatiques et environnementaux ? Avons-nous encore les moyens d’éviter ou d’amortir cette éventualité ? Si la curiosité humaine semble faire l’unanimité, comment faire de cette curiosité une force pour s’assurer collectivement un avenir durable ?















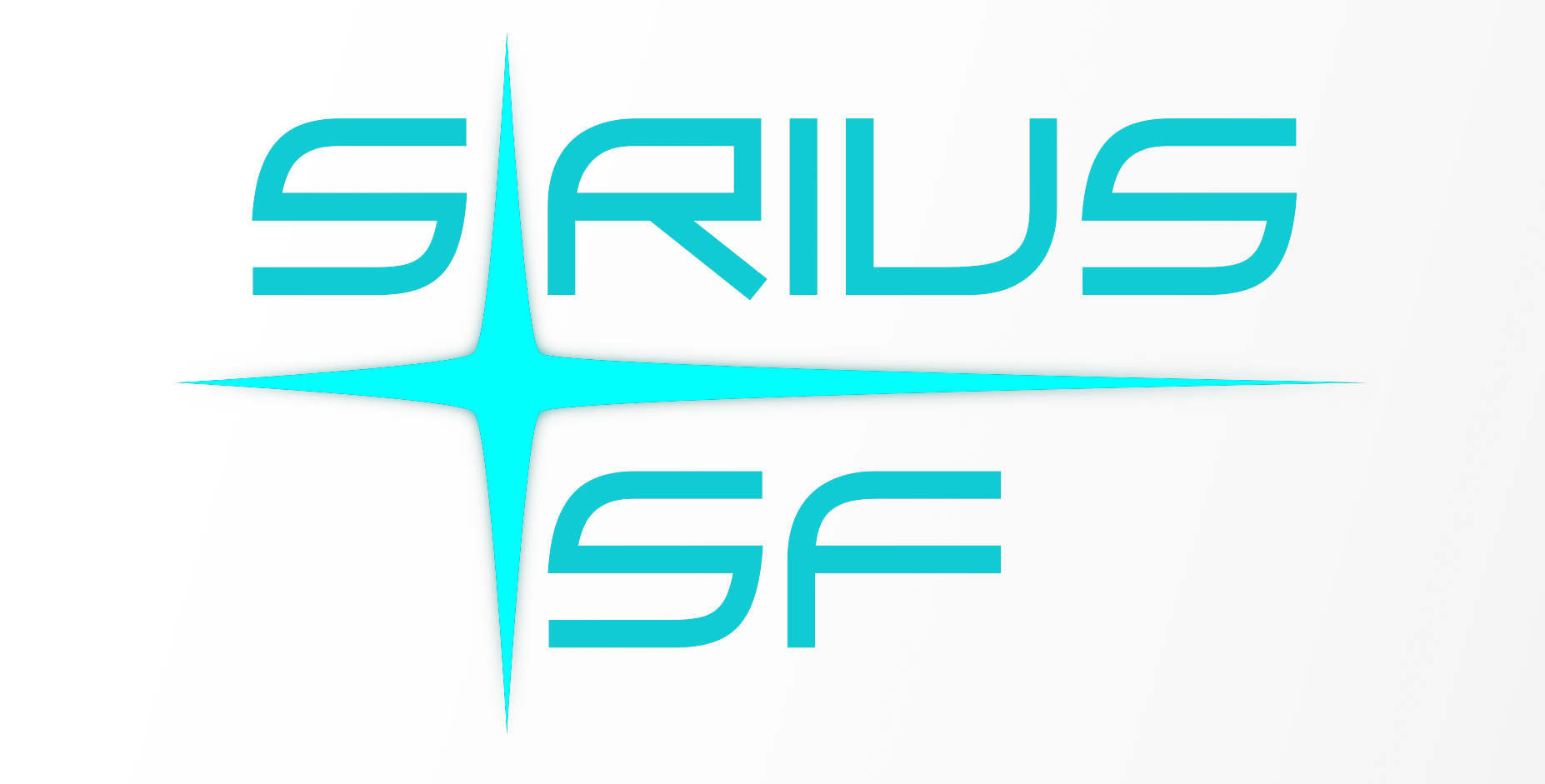

Comments are closed.