Toujours dans le renouvellement de l’exploration du présent, à la lumière d’avenirs multiples, FuturHebdo propose une série d’interviews de personnalités qui, chacune dans leur domaine, sont à la jonction de la société du savoir, de la recherche, et du grand public. Chacune de ses personnalités nous propose sa vision de la place des sciences dans nos sociétés modernes, de la vulgarisation, de la prospective, cette interrogation du présent par le futur…
Tous les interviews seront construits selon la même structure afin de permettre une lecture comparée de ces interviews, entre eux, d’en faire une lecture synoptique.
Aujourd’hui : Gilles Babinet, Digital Champion de la France auprès de l’UE
Une production Le Comptoir Prospectiviste.fr/Futurhebdo.fr
Olivier Parent (FuturHebdo) : Bonjour, Pouvez vous nous dire où nous sommes et vous présenter en quelques mots ? Quelles sont vos activités dans les domaines des sciences ?
Gille Babinet : C’est un sujet qui me passionne depuis toujours car c’est au cœur de la révolution… le capital humain, et donc je m’intéresse à la foi à ce que sont les pédagogies pour le jeune âge, l’école primaire en particulier et en même temps à l’enseignement supérieure et les formations professionnelles. Et, d’une façon plus générale : comment est ce qu’on apprend à innover, comment on apprend travailler dans des logiques de rupture car c’est passionnant.
Donc dans ce cadre, j’ai plusieurs activités : je suis au conseil d’administration d’une start up qui fait des mooks. Je suis très impliqué dans l’institut Montaigne. On vient de publier un rapport sur l’enseignement supérieur et numérique, et puis c’est un sujet que j’aborde dans mes livres et conférences.
OP : A votre sens la relation entre le savoir érudit scientifique et le savoir populaire est elle en train d’évoluer ?
GB : C’est très intéressant, c’est d’ailleurs je crois un objet de fascination. C’est à dire qu’on se rend compte que Wikipédia arrive à faire un travail plus profond et plus complet que la Britanica, c’est fait par une poignée de quelques dizaines de scientifiques, de très haut niveau, de Cambridge ou de Stanford. Wikipédia est fait par la multitude. On voit bien que, semble-t-il, à part les biographies des hommes politiques, qu’il y a moins de fautes sur Wikipédia. Si bien que l’on peut vraiment transposer ce mécanisme partout…
Et au delà de ça, il y a les travaux de recherches, le fait d’utiliser les plateformes comme eyeka.com ou INNOcentive, pour découvrir des choses nouvelles. Moi, j’aime citer cette anecdote qui a lieu sur INNOcentive : Quand on a eut cette marée noire, dans le golfe du Mexique, on a dépollué et on s’est retrouvé avec des centaines de barges qui faisaient je crois comme 120m de long, 5m de large et 5m de hauteur. Donc, avec des centaines de milliers de cubes d’eau qui étaient pollués. On a fait un appel d’offre sur INNOcentive, qui a abouti à ce que quelqu’un dise : “moi j’ai un enzyme qui sait “bouffer” le pétrole” et qui sait polluer, donc.
Et c’est valable, dans le domaine de l’innovation, on va dire, très appliquée comme dans la recherche fondamentale, c‘est à dire qu’on peut voir des choses étonnantes apparaître dans les recherches fondamentales. Des sites comme Archive.org, on voit des gens qui ont des contributions très importantes et qui ne sont pas objectivement référencés par la science connue.
Je vous citerai un autre exemple. j’étais il y a quelques semaines, ici, dans ce salon, avec un garçon qui est un expert de Grothendieck, un très grand mathématicien mort il y a quelques années, et bien, il y a quelques mois même… et bien, ce gars-là n’est pas, ne travaille pas au sein d’une université. Donc, on a là une rupture de paradigme forte.
Je crois que si on arrive à automatiser ça, avec des plateformes notamment, on peut accroître le champs des possibles, d’une façon importante.
OP : Quels rôles tiennent les sciences dans la construction permanente, de nos sociétés, de nos esprits ?
GB : Ah ça, c’est un très bon sujet d’épistémologie, qui a été assez couvert mais qui évolue de façon forte, parce que la construction du consensus et l’établissement de la vérité, c’est plus uniquement ce qui est irréfutable. C’est aussi une sorte de perception commune.
C’est très bizarre la façon dont les choses évoluent et je pense que la notion de réfutation… c’est terrible, ca va être critiqué ce que je vais dire… mais elle est dépassée, notamment dans le contexte des intelligences artificielles, il va falloir que l’on trouve d’autres moyens d’établir la construction de la vérité.
C’est plus une réflexion « dialectique », de construction du dialogue qu’une réflexion à proprement scientifique mais ca y participe parce que on s’aperçoit que la science est totalement pétrie de religion. Il faut être conscient de ça. C’est un fait même si c’est désagréable à entendre. Il y a des consensus comme en science, Lyssenko est un très bon exemple : il découvre quasiment l’épigénétique 80 ans avant qu’on la fasse apparaître, et le néo-darwinisme était le consensus commun jusqu’à il y a 20 ans, à peu près. Donc, il faut bien comprendre ça.
Et, je pense que l’explosion du monde, l’orientalisation du monde remet plus que jamais en cause ces notions de verticalisation de la science.
OP : Comment faire de la connaissance un objet d’émerveillement face à la complexité du monde et non une contrainte à apprendre, à acquérir à l’université ?
GB : La science oscille toujours entre la liberté et l’orthodoxie. C’est à dire que finalement une science réfutable est une science très très orthodoxe : on a des canons de vérification, avec des comités scientifiques. Mais c’est une science qui peut devenir assez totalitaire, du moins, je crois que c’est souvent le cas. Quand j’observe dans les laboratoires, dans certaines disciplines, ce qui se dit… finalement l’exemple de l’épigénétique est un bon exemple, la façon dont ça vole en éclat, soudainement… ça me pousse à penser qu’il faut sans doute un peu plus “d’élasticité”…
Un des grands enjeux du 21e siècle est d’arriver à articuler la verticalité et l’horizontalité en science. C’est à dire, faire en sorte qu’il y ait des plateformes de co-créations qui permettent de faire participer un peu tout le monde, et avoir des processus de qualification et réfutation qui soient très très fermes. Et je pense que les principes de comités scientifiques sont quand même largement dépassés. Ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas faire la réfutation. Mais, on peut faire la réfutation avec d’autres processus…
OP : Les sciences ont la fâcheuse tendance à devenir de plus en plus complexes, et cela à un rythme toujours plus soutenu. Quels moyens a la société, qui lui permettrait de continuer à intégrer ce que les sciences lui présentent, pour continuer à apprendre, à utiliser, toujours plus d’innovations, issues de ces recherches ?
GB : Alors, il y a le ré-enchantement des sciences, c’est à dire : on redonne envie aux gens de s’intéresser aux sciences. Je pense qu’il y a quand même une clé intéressante : c’est la notion de pluridisciplinarité. On voit bien que les théories unificatrices sont modérément à la mode, et donc, on voit bien qu’il faut aller chercher dans d’autres disciplines pour réussir à comprendre un monde qui ai fait de complexités.
Je pense à la physique qui s’appuie beaucoup sur les mathématiques. Mais, au delà de ça, on a tout un tas de croisements de disciplines qui sont intéressants. Et ça, pour moi, c’est une opportunité d’aller chercher des gens qui auraient peut être une lassitude à étudier que des maths… Moi, je le vois, quand on confronte les gens à des environnements pluridisciplinaires, ils s’émerveillent, beaucoup plus qu’auparavant. Donc ca c’est une vraie clé.
Et puis, la notion, d’une façon générale, de science ouverte, et ce n’est pas que virtuelle, pas que des plateformes digitales… c’est aussi le fait de pouvoir participer à des travaux de recherche scientifique, dans certains cadres, et c’est un paradigme très nouveau pour le monde universitaire. C’est à dire que la plupart des universités ont une très grande frilosité, à l’idée de s’ouvrir à des gens qui ne sont pas « préqualifiés ». Pourtant, on voit que ça donne des résultats, parfois, tout à fait intéressant. Je pense à des expériences d’open science dans le domaine des maths, j’ai eu l’occasion de parler à des grands chercheurs dans ce domaine, et ils me disent : “Effectivement, on peut chercher de façon verticale et parfois on est confronté à des enfants qui vous déstabilisent par leur compréhension de ces enjeux-là.
OP : Comment créer des passerelles entre la société civile et le monde de la recherche ?
GB : Alors il y a des initiatives qui ont déjà été prises et qui mériteraient d’être rappelées ici. Je pense à La main à la pâte, remarquable initiative, et il n’y a pas que ça. Il y a d’autres initiatives aussi dans d’autres domaines. il y a donc les plateformes, c’est certain que c’est une façon d’ouvrir la science, de façon forte, en France, c’est assez peu envisagé. Et puis, je pense qu’il faut regarder des initiatives généralement anglo-saxonnes qui consistent à ouvrir les laboratoires, faire en sorte que l’on puisse avoir réellement des collaborations fortes sur certains labos. Moi j’ai vu ça, c’était peut-être un peu exceptionnel, à Harvard : il a des initiatives de ce type là… à Cambridge aussi me semble-t-il. Donc, c’est important d’essayer de systématiser ça, autant que faire se peut. Et, contrairement à ce que l’on croire : on abaisse pas le niveau quand on fait ça, c’est à dire qu’on élargit le spectre des possibles plus qu’autre chose. Et j’observe, très modestement, sans être un scientifique, ca m’arrive d’avoir des discussions avec des scientifiques et au cour desquelles on peut évoquer des perspectives qui ne sont pas leurs perspectives traditionnelles.
OP : Quel est le rôle de la vulgarisation ? est elle nécessaire, indispensable, a-t-elle même pu être dangereuse ?
GB : Je ne vois pas en quoi on pourrait dire que la vulgarisation puisse avoir des travers, quels qu’ils soient. La vulgarisation est essentielle et les sciences sont quand même un élément du débat au sein de la société civile… Le potentiel qu’elles ont, leur capacité à quand même créer du consensus à large échelle : c’est important.
J’observe, dans les débats actuels, par exemple, si je prends, et c’est peut être contesté par certains auditeurs, mais le débat sur les vaccins, il est pétri de non science. C’est à dire que j’ai parlé à des tas de gens, parfois très critiques, sur l’utilisation de l’aluminium dans les vaccins : c’est nécessaire, souhaitable et efficace et les contre-indications sont extrêmement rares…
Donc, il faut de la vulgarisation en science. C’est important. Il n’y n’en a pas assez, d’ailleurs. Et, peut-être ce qu’il faut c’est qu’elle change de format, c’est à dire que les enfants regardent peut être moins la télé qu’auparavant, les revues scientifiques, par définition, avec Internet, il s’en vend moins. Donc, c’est peut-être plus des pastilles à faire en vidéo, sur Internet… des choses qui vont sur les réseaux sociaux… et je crois que c’est aussi la mission, à la fois des autorités politiques mais aussi des laboratoires de recherche et des universités d’adopter ces formats. Ce qu’elles ne font pas assez. Les américains sont incontestablement plus forts que nous, pour créer une sorte de consensus et un modèle pédagogique. D’abord, ça attire les gens vers les sciences et, en plus, ça crée du débat sur leur application et potentiellement des contributions en matière de recherche fondamentale. Donc, c’est absolument essentiel de faire ça.
Je ne crois pas qu’il puisse exister de science sans diffusion de la science, c’est à dire qu’une science qui ne serait pas diffusée, pour moi, elle est sujette à justement, le cadre épistémologique d’une science qui serait secrète est très contestable. Parce que : est-elle est réfutable ? est-ce qu’on peut la répliquer ? etc…
Il faut observer, d’ailleurs, ce qui se passe dans certains cercles où on parle de pseudo-science, par exemple les mouvements perpétuels il y a pleins de choses sur ces notions-là, par exemple, c’est pas réplicable… On vous explique les théories du complot… on est proche de ce qu’on appelle les “alternative facts” aux Etats Unis.
OP : A t’on le droit de convoquer l’imaginaire pour faire de la vulgarisation scientifique ?
GB : Bien entendu ! C’est fondamental. Je dirais même que les mondes imaginaires d’il y a 50 ou 100 ans sont la réalité d’aujourd’hui, donc c’est essentiel. Et, en physique en particulier, quand vous voyez les capacités d’abstraction qui sont nécessaires, je pense à la physique quantique, à l’astrophysique également, et tous ces enjeux de représentation multidimensionnel, dans le temps ou dans l’espace, ce sont des enjeux très compliqués, on voit l’apport que peut avoir la Science-Fiction et nombreux sont les scientifiques qui concèdent avoir eu une sorte de déclic après avoir lu un roman. Donc c’est très important, et je pense que c’est là où on voit la richesse d’une société civile complexe : là où il y a de l’art, du roman, de la fiction et aussi des sciences dures. Ces choses là vont parfaitement ensemble.
Evidemment, on peut penser que c’est un peu une déclaration pleine de bonnes intentions qui fait qu’on est tenté naturellement de dire ce genre de choses. Mais non : factuellement, c’est nécessaire. Et d’ailleurs, on voit de plus en plus, soit dans le numérique ou dans le domaine universitaire, la volonté de rapprocher les disciplines des sciences dures et sciences molles, parce que c’est aussi une façon de faire exploser les perceptions.
OP : Il y a toujours une recherche plus ou moins longue entre une recherche et son application dans la société civile. Est il alors pertinent d’essayer d’envisager les impacts d’innovation avant même leur arrivée dans la société de consommation et donc d’en faire une prospective ?
GB : L‘autre jour, je lisais un texte de Edgar Morin qui disait : “L’histoire n’est jamais linéaire, elle n’est que composée de ruptures”. Et je pense que l’histoire des sciences aussi. De ce fait, les travaux de prospective n’ont de valeur que si on accepte qu’il soit une prospective. On peut s’appuyer dessus, dans le cadre des grands équipements scientifiques, on peut prendre des décisions d’investissement en fonction d’attentes prospectivistes, mais je crois qu’il faut conserver la latitude d’aller voir ailleurs, également. On ne saura si l’investissement de Iter a du sens que dans probablement 15 ou 20 ans et d’ici là c’est un gros coup de poker…
OP : Sans être une discipline scientifique, la prospective est une tentative ouverte de modélisation de l’avenir, et les sciences fournissent la plupart des postulats indispensables à la construction d’une prospective. En quoi cette démarche peut être utile dans l’appropriation de la complexité grandissante du présent et la construction des sociétés de demain ?
GB : Alors, pour moi la prospective, elle est plus utile, en matière d’actions politique qu’en matière scientifique. C’est à dire que, finalement, les scientifiques ont une vision, la vision de faire la fusion chaude et il y a plusieurs façons d’y arriver : on voit les allemands avec des tokamak arrivent à faire des choses qui sont assez surprenantes. Mais en réalité, ceux qui ont du mal à sortir du présent, c’est pas les scientifiques. Les scientifiques, ils sont capables de se projeter dans des intentions parfois extrêmement alternatives. Ceux qui ont du mal à le faire, c’est les acteurs politiques et donc, il faut être capable de leur détailler ce que peut faire un Iter ou un autre équipement. Et je dirais que, tout à l’heure, on évoquait la notion de vulgarisation : la prospective, c’est aussi une sorte de vulgarisation, c’est à dire c’est projeter le geste scientifiques, d’une façon vulgaire, pour le néophyte
Si l’énergie était possible à partir de type Iter, elle serait pour ainsi dire gratuite et on voit bien que l’énergie est un outil fondamental de notre monde et tout deviendrait différent. Et c’est ça, je pense, que les scientifiques comprennent et que les politiques ne comprennent pas. Donc la prospective, c’est un peu comme Einstein, c’est un peu malheureux, mais qui va voir Eisenhower ou Truman, je ne sais plus, qui leur dit : “Voilà, on peut faire une bombe !” Donc, lui, il a déjà cette capacité de projection. Les politiques ne l’ont pas. Et donc quand je parle d’une société civile seine ou efficace, c’est dans sa capacité, de communiquer entre des corps qui sont de nature très différente.
OP : La prospective est à envisagée comme une expérience de pensée, une spéculation parfois transgressive, souvent génératrice de ruptures, d’ailleurs certains rapprochent la prospective des sciences humaines. A-t-on le droit d’appliquer la prospective à la recherche scientifique, l’avenir de cette recherche comme celui de la consommation, est-il lié à des innovations ? A des technologies de rupture ?
GB : L’expérience de pensée c’est le propre de la science. Maintenant, on a quelque chose qui arrive c’est que l’expérimentation est faite par des machines. Donc, quand vous êtes à la recherche d’un type de molécule, d’interactions… là, on sait que les ordinateurs savent bien modéliser ça… ils peuvent le faire de façon statistiques, à très grande volée. C’est pas l’intuition du scientifique. C’est plus, ce sont des choses finalement assez simples qui sont crées et c’est un outil qui devient de plus en plus présent dans les sciences.
Maintenant, venant du monde du numérique, moi, je vous dirais, même en ayant l’idée d’intelligence artificielle profonde, j’ai du mal à voir comment émergerait cette espèce de fulgurance qui arrive parfois, parce que pour ceux qui l‘ont vécu, ça a quelque chose de très surprenant. Connaissant le fonctionnement des réseaux de neurones, moi, je vois surtout des travaux proches de logiques statistiques. Je ne dis pas qu’il ne pourrait pas y avoir de résultats étonnants, et parfois « aberrant », qui proviennent des machines artificielles, mais je pense que, pour le moment, cette fulgurance je n’arrive très bien pas à la concevoir dans la machine.
OP : Auriez vous une prospective à partager avec nous ?
GB : Actuellement, je m’intéresse beaucoup à tout ce qui est interactions, entre système d’intelligence artificielle et cognition. Je pense qu’un champs prospectif qui n’est pas exploré, c’est le domaine de l’intime, c’est à dire la capacité de travailler sur les troubles psychiques avec l’AI. Je trouve qu’il y a un vide très important dans ce domaine, et c’est assez normal en fait parce que, comme je le dis souvent : “ce qui ne se mesure pas, n’existent pas”, et dans ce domaine, la notion de feedback, c’est des impressions, des choses qui sont très évanescentes et de ce fait, c’est difficile d’emmener technologie dans cet univers. Mais, c’est sans doute pour ça que c’est passionnant d’y aller.

















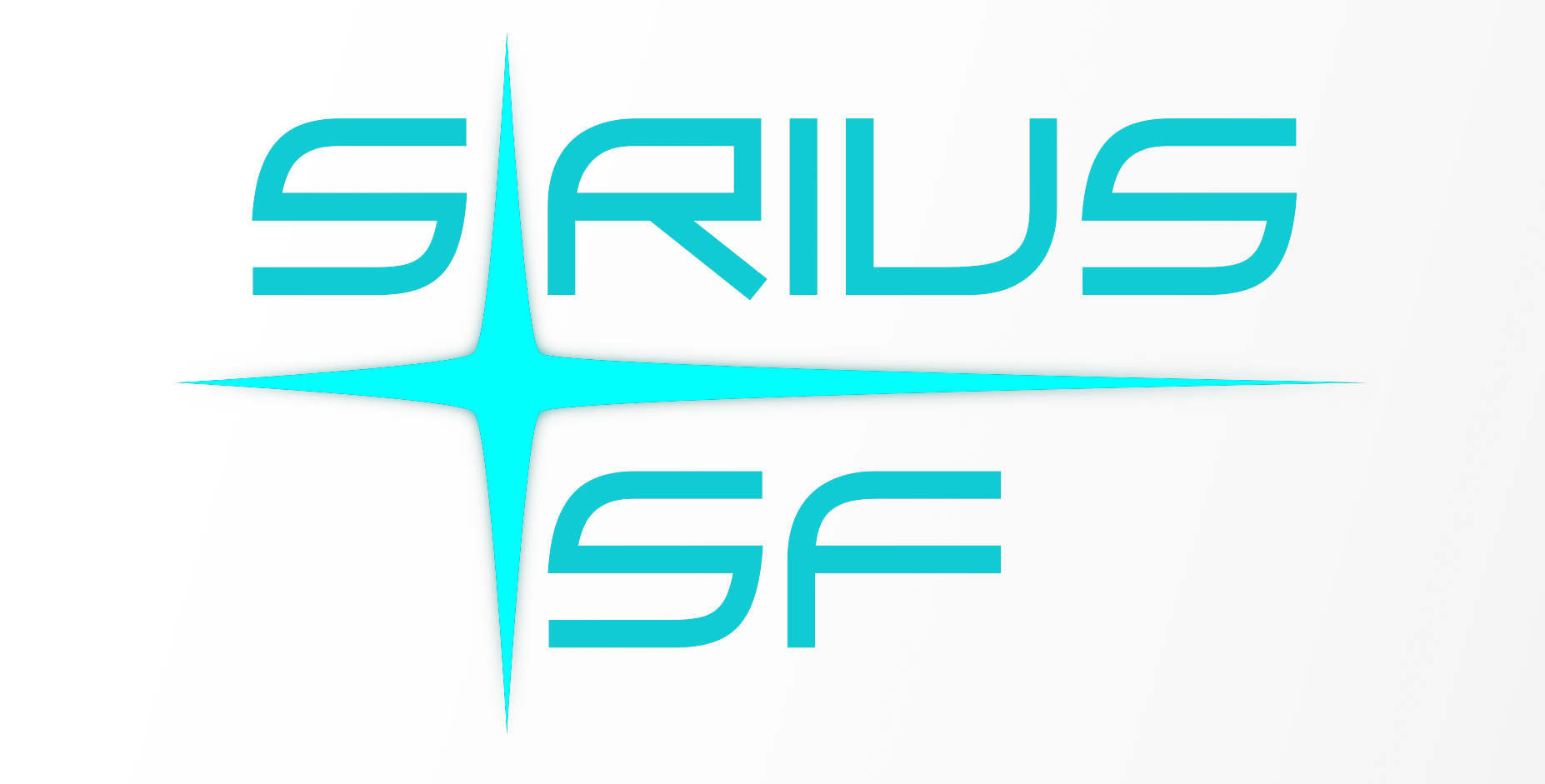

Comments are closed.