Le récit de science-fiction fait partie de la grande famille des récits d’imagination. La science-fiction a ceci de particulier qu’elle est née au moment de la Révolution française, avec l’arrivée à maturité des sciences, elles-mêmes annonçant les prémices de l’ère industrielle et ses conséquences sur l’individu aussi bien que sur les organisations humaines. La science-fiction a pris son envol au cours du XXème siècle. Ce siècle précède l’entrée de l’humanité dans un nouveau millénaire (bien que rien ne soit plus relatif qu’un calendrier…). Ceci conférant à ce même siècle une dimension parfois apocalyptique ou, en tout cas pour certains, millénariste. Enfin, au cours de ce dernier siècle, avec l’aggravation de la situation environnementale de l’humanité, le récit de science-fiction devient alors récit prophétique, tout à la fois Armageddon et Utopia. Mais, plus que tout, la science-fiction pourrait bien s’avérer une tentative de rationaliser l’irrationnel.
Après ce préambule, c’est à un voyage en terres imaginaires auquel je vous invite… à la découverte d’un genre artistique qui, souvent taxé d’irrationnel, se révèle ne pas l’être autant que cela… à la découverte d’un mode d’expression qui se sert de l’irrationnel de mondes hypothétiques pour inviter le lecteur, le spectateur à entrer dans le rationnel de son propre temps.
Un peu d’ontologie…
Après le siècle des Lumières, les sciences devenues modernes — et libérées de la tutelle du religieux et avides de compréhension — se sont lancées dans l’exploration du monde qui se prêtait à la perception des sens immédiats. Cette mise en coupes réglées de la Nature par l’expérimentation a eu pour conséquence, parmi d’autres, de sans cesse réduire les différences et la distance entre les humains et les animaux, à tel point que pour nombre de nos contemporains du XXIème siècle, il n’y a plus guère de distinction entre eux-mêmes et leur chat, leur chien ou toute autre forme de vie… Si bien que tenter d’établir une liste de ce qui distinguerait l’humain de l’animal se réduit à une énumération bien maigre… mais qui n’en reste pas moins essentielle.
On pourrait commencer par énoncer que l’humain est le seul animal qui sait qu’il va mourir… bien que cet argument ne puisse pas être recevable, par certains, du simple fait de l’incapacité des humains à communiquer avec les autres espèces vivantes : on pose des questions humaines aux animaux, et il semblerait qu’on ne reçoive rien en retour, aucune réponse. Ne faudrait-il pas poser des questions de chat à un chat, d’orang-outan à un orang-outan, d’épaulard à un épaulard et ainsi de suite ? Mais alors, la capacité d’adapter notre communication à d’autres espèces ne deviendrait-elle pas un caractère propre à l’être humain ?
Essayons de cerner une autre capacité : si quelques animaux savent utiliser le feu, c’est, jusqu’à ce jour, uniquement par opportunisme. Il n’y a encore que l’homme qui en maîtrise la production. Il lui aura tout de même fallu un peu plus d’un demi-million d’années pour passer de l’utilisation opportune du feu — comme celui allumé accidentellement par la foudre — à la maîtrise de cette technique, à la base de toute civilisation humaine. L’utilisation du feu d’origine naturelle, par Homo Erectus, pourrait remonter à 1 million d’années, quand sa maîtrise, par Homo Néanderthalensis, serait datée à -450 000 ans. Il va donc se passer encore un certain temps avant de voir un Milan noir, un rapace du nord de l’Australie, allumer un feu avec un outil alors qu’il sait, dès aujourd’hui, utiliser et déplacer des brindilles enflammées, pour incendier un territoire et débusquer ainsi ses proies affolées par le feu.
Par ailleurs, bien que les preuves que les animaux savent compter — soustraire, diviser — s’accumulent, il n’y a toujours que l’homme pour avoir conceptualisé cette capacité, à avoir développé les mathématiques, dans le cadre d’un grand œuvre de modélisation de la réalité, en utilisant des outils intellectuels qui n’ont eu de cesse de s’éloigner de l’intuition immédiate. Il n’y a que l’humain pour comprendre l’utilité du logarithme naturel qui rend linéaire une progression géométrique… que l’on peut « prédire » l’apparition dans le ciel de corps célestes grâce aux équations de la gravitation universelle de Newton… que le chaos est indissociable du réel, non pas dans le sens d’absence d’organisation mais dans celui d’absence de déterminisme…
… pour remonter aux origines du récit imaginaire
Dernier attribut qui, jusqu’à ce jour, semble rester le propre de l’humain est le récit d’imagination. Cette narration est intimement liée au langage humain qui, lui, ne doit pas être confondu avec la parole. En effet, la parole, cette capacité à émettre des sons porteurs d’informations est assimilable à la communication qui existe au sein des espèces vivantes : ainsi, en cas de danger, les arbres sont capables de communiquer au moyen de messages chimiques transmis, d’arbre en arbre d’une même espèce, grâce à des phéromones portées par le vent. Les arbres disposent d’autres moyens de communication grâce, par exemple, à des échanges électro-chimiques transmis au travers de réseaux micellaires que font pousser certains champignons à leurs environs. Dans le règne animal, il faut aussi évoquer le langage corporel et symbolique — mathématiques — des abeilles qui, par leurs danses frénétiques, savent renseigner leurs congénères sur la direction à suivre et la distance à parcourir pour aller vers un champ découvert au hasard d’une pérégrination champêtre, un champ riche en fleurs, afin d’en collecter le pollen… Les abeilles font de même quand elles doivent migrer : les éclaireuses savent décrire les trous d’arbre qui pourraient accueillir l’essaim sur le départ. Une fois la décision prise de manière collective, 10 000 abeilles s’envolent, en quelques instants, vers un nouveau destin.
Du côté des primates, on pourrait évoquer les colonies de macaques du Japon qui ont appris, sans l’intervention de l’homme, à laver leur aliments. Ce comportement culturel — non génétique — se voit transmit de génération en génération… quand les sons émis par d’autres primates sont étudiés avec toujours plus d’attention pour y déceler un lexique utilisé au sein d’une syntaxe au profit d’une sémantique qui leur sera sûrement propre… Ces découvertes récentes, et des expériences d’apprentissage du langage des signes chez un chimpanzé, plus anciennes, mettent en lumière la capacité de transmission de connaissances entre individus et d’une génération à une autre, ce que, en d’autres termes, on appelle des cultures non humaines, des cultures pour lesquelles l’Humanité ne doit avoir de cesse de s’étonner, de chercher à les comprendre et de respecter les êtres qui les produisent.
Pour autant, ces communications, même si elles sont paroles chimiques, électriques, acoustiques, sont-elles pour autant langage ? Savent-elles dépasser la simple transmission d’informations. Portent-elles du symbolique, de l’abstraction, de l’imaginaire ?
Transmis par la parole, le langage humain, lui, serait né plus ou moins concomitamment au long chemin qui a mené à la maîtrise du feu — c’est ce que laissent apparaître les dernières recherches — le « tout » aboutissant à l’émergence de l’humanité moderne. Le feu, une fois maîtrisé, permit aux groupes pré-humains de s’affranchir de la lumière du soleil et d’allonger ainsi la durée de leurs activités. Indépendamment des avantages nutritionnels qu’apportent les aliments cuits, le feu permit aussi de renforcer le sentiment de sécurité et d’appartenance au groupe. Autour du feu, les mâles ont pu s’occupés des petits, permettant aux femelles de vaquer à d’autres occupations… peut-être était-ce pour danser ou chanter… Autour du feu, aux origines de ce qui allait devenir société humaine, le langage s’est structuré. Il a exprimé le passé, le futur, le conditionnel… il est devenu emphatique, symbolique, abstrait… et, là, le récit imaginaire est né.
A également lire : Peuplades virtuelles | 08/12/2058
On notera que ce récit a des points communs avec les mathématiques : comme elles, il est tentative de modélisation de la réalité en en proposant une abstraction. Comme elles, le récit imaginaire est une réduction de cette même réalité, il en est même une recréation selon des règles établies par le narrateur, mais surtout, et cela est propre au récit d’imagination, selon des règles accessibles au plus grand nombre, compréhensibles par les humains assis autour du narrateur, des règles partagées par sa tribu, la société dont il est artiste, la culture qui lui a donné naissance.
La fable philosophique, prototype du récit de science-fiction
Dès les temps humains les plus anciens, le récit d’imagination a pris bien des formes. Ce furent les récits des origines, les cosmogonies et autres mythologies. On a tous été bercé par les mythologies égyptiennes, nordiques, grecques… Puis, ce furent les hauts faits des rois, des monarques et des héros : des chroniques dignes des meilleures propagandes politiques modernes qui s’égrainent tout au long de l’histoire de l’humanité. Elles imposent d’ailleurs aux historiens modernes un fastidieux travail d’une permanente redécouverte pour y discerner les faits historiques, de la mythologie et des manipulations avantageuses.
Le récit d’imagination, qu’il soit politique ou non, a surtout tenu un grand rôle dans la construction des sociétés humaines. Les contes et les légendes portèrent de tous temps une sagesse dite populaire, transmise de génération en génération, par voie de tradition orale, à la lueur des flammes des feux des veillées… Bien avant l’émergence du temps scientifique, le récit d’imagination a donné à la pensée humaine un moyen de vulgarisation, propre à diffuser les connaissances d’une civilisation, les interrogations d’un temps, les peurs d’une époque.
C’est ainsi que l’un des plus anciens récits d’imagination qui nous soit parvenu se nomme L’épopée de Gilgamesh. Nous avons pu en hériter car il a été figé sur des tablettes d’argile couvertes de caractères cunéiformes, écrits par des mains anonymes, voilà environ 4100 ans. Ces tablettes ont surtout été redécouvertes, au milieu du XIXème siècle, sur le site de l’antique cité de Ninive, lors de fouilles, dans les faubourgs de Mossoul, en Irak. Le Gilgamesh dont il est question est roi, mi-homme, mi-dieu. Pourtant, cette première œuvre littéraire traite bien de la condition humaine, de ses contingences, de ses peurs, des nécessaires grandeurs que sont l’amitié, la quête de la sagesse… Ce texte a pour titre complet « L’épopée de Gilgamesh : le grand homme (roi) qui ne voulait pas mourir ». Il tient autant de la mythologie polythéiste que de l’aventure héroïque, thèmes qui seront repris, 1300 ans plus tard, dans L’Iliade et L’Odyssée d’Homère. Ces deux poèmes épiques (issus de l’auteur hellène le plus célèbre dont, paradoxalement, l’historicité — la réalité historique — fait toujours débat) seront transcrits entre les VIème et IIIème siècles avant J.C. Ils intègrent ainsi le « viatique culturel occidental ».
On peut ensuite citer un autre exemple de récit qui, petit à petit, nous mène vers la forme moderne du récit imaginaire qu’est le récit de science-fiction. Il s’agit du mythe juif du Golem, issu, lui aussi, d’une tradition orale et mais, cette fois, dans le cadre d’une culture monothéiste. Il sera couché sur le papier au cours du XIIIème siècle après J.C. Ce récit raconte les affres de la tentation et les conséquences d’une aspiration propre à l’humanité : créer. Cette tentation pris la forme du Golem, un être anthropomorphe fait de glaise. Sous prétexte d’apporter protection à une communauté persécutée, il était « activé » en traçant sur son front אמת (emet), le mot vérité en hébreu. Pour l’arrêter, pour « l’éteindre », il suffisait d’effacer l’aleph (א), la première lettre du mot tracé sur le front du Golem. Ce mot devenait מת (met) qui, toujours en hébreux, signifie mort. Procédé somme toute binaire… pas loin d’une forme de technologie même si le Golem tirait son « principe animé » de la présence, dans sa bouche, d’un parchemin sur lequel était écrit le tétragramme, le nom de Dieu qui ne doit pas être prononcé.
Après un nouveau bond en avant dans l’Histoire, au tout début de la Renaissance, là, en 1516, Thomas More écrit Utopia, la célèbre fable philosophique qui tire son nom de l’hypothétique île d’Utopia. Ce texte qui décrit une société idéale a ceci de remarquable que son titre — néologisme composé des étymons grecs eu (bon) et topos (lieu) — va devenir utopie, le mot qui, aujourd’hui, désigne tout ce qui tend vers un idéal, mais qui demeure de l’ordre de l’irréalisable. L’utopie englobe aussi la conception et la description des rapports humains dans une société qui serait parfaite.
Ainsi, présente dès l’Antiquité jusqu’à Révolution française, la fable philosophique, chère à Jean de la Fontaine, à Voltaire et aux autres promoteurs de la connaissance et des sciences du siècle des Lumières, trouve, dans Utopia, sa forme archétypale et peut être considéré comme une des graines desquelles va se déployer le récit de science-fiction et toutes ses variantes.
De la naissance de ce qui va devenir le genre Science Fiction…
Encore un saut dans le temps pour s’arrêter sur un binôme d’œuvres, séparées l’une de l’autre d’une petite trentaine d’années et qui marquent la naissance de la science-fiction à proprement parler : il s’agit, d’une part, du Miroir des événements actuels ou la Belle au plus offrant, Histoire à deux visages de François-Félix Nogaret (1790) et, d’autre part, de Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley (1818). Ces deux textes sont liés par d’étonnantes similitudes. Ils mettent tous deux en scène un inventeur (Frankésteïn/Frankentein) qui créent un être artificiel (automate/assemblage de membres humains). Mary Shelley s’est-elle inspirée, consciemment ou non, de Nogaret ? Tel n’est pas le propos de cette démonstration. Ce qui, par contre, est fondamental, dans ces deux textes, est la substitution du pouvoir magique (par exemple, le binôme hébreux emet/met qui « pilote » le Golem) par le fait technologique pour créer, animer un être artificiel. Au moment de la rédaction de ces deux œuvres, l’électricité en est à ses prémices : en laboratoire, elle n’est encore que statique. Si bien que, quand l’automate de Nogaret est mû par la seule force mécanique, c’est grâce à l’électricité que Mary Shelley permet au docteur Frankenstein d’animer sa créature, en lui administrant un gigantesque électrochoc, en captant la foudre, la plus puissante des sources d’énergie électrique connues à cette époque.
A compter de ces dates fondatrices, le récit fantastique, qui n’est pas encore nommé science-fiction, va suivre, tout au long du XIXème siècle, les évolutions de la toute jeune civilisation industrielle, nourrie de la fascination que celle-ci provoque en Occident. Avec l’apogée du scientisme industriel, on voit, en Europe, se succéder les merveilleuses expositions universelles qui mettent en scène, devant les foules ébahies, la fée Électricité, la puissance de la vapeur et les promesses des vols en dirigeables. Mais toutes ces démonstrations scientistes masquent, plus ou moins habilement, un versant moins reluisant de l’industrialisation galopante de l’Europe et du monde : le travail non réglementé des populations, hommes, femmes et enfants, qui furent rurales. Ces foules laborieuses, souvent exploitées et peu instruites donnent naissance à la classe ouvrière… À tout cela, on peut ajouter l’esprit colonialiste et la persistance de l’esclavagisme, qui justifièrent les « zoos humains », un des aspects parmi les plus sombres des expositions universelles.
Parallèlement à ces événements politico-industriels, deux géants de la littérature proposent deux visions de cette folle époque qu’est la deuxième moitié du XIXème siècle. Il y a tout d’abord, en France, Jules Verne qui enchante ses lecteurs au gré de plus de 80 romans et nouvelles fantastiques, pendant que de l’autre côté de la Manche, H. G. Wells s’attache à une vision moins idyllique, moins utopique — aujourd’hui, on dirait dystopique — du monde qui devient moderne. L’un et l’autre mettent en scène les techniques de leur époque, comme d’autres pas encore maîtrisées ou même fantaisistes. L’un et l’autre commencent à explorer les conséquences de ces technologies sur les individus, la société et le monde. Ainsi, avec Jules Verne et H. G. Wells, et riche de ses origines — le récit mythique et la fable philosophique — le récit de science-fiction est né, même s’il n’en porte pas encore le nom. En effet, il faudra attendre l’entre-deux-guerre, pour que, des États Unis d’Amérique, nous vienne cette dénomination.
Entre temps, ce qui est encore récit fantastique va donner naissance à des créations étonnantes, plus ou moins connues, mais qui vont structurer la forme moderne du genre « science-fiction ». On peut évoquer, ici, Le talon de fer de Jack London (1908). Ce roman est l’analyse par un observateur du XXIVème siècle d’une hypothétique révolution socialiste advenue entre 1914 et 1918… Ce roman est le précurseur d’une science-fiction critique. Il est une réponse sociale au scientisme du siècle qui vient de s’achever, tout comme l’œuvre de H. P. Lovecraft en propose une alternative fantasmagorique et cosmique, oscillant en permanence entre science-fiction, horreur et récit de la folie des narrateurs successifs.
Il faut ensuite citer la pièce de théâtre R.U.R (Rossum Universal Robots) de Karel Capek (1920) qui met en scène le sort d’esclaves artificiels des temps industriels. À partir du slave rob (esclave), Capek et son frère créent le mot robot. Puis vient le film Metropolis de Fritz Lang (1927) : il est considéré comme le premier chef-d’œuvre cinématographique de science-fiction, même si les penchants pour le nazisme de la scénariste Thea von Harbou donnent au film, au corps défendant du réalisateur, une aura légèrement sulfureuse. Il ne reste plus qu’à évoquer le « coup médiatique » que réussit Orson Wells qui, en 1938, adapte, à la radio, aux USA, La guerre des mondes de H. G. Wells. La légende veut que la qualité de cette radiodiffusion qui annonçait l’arrivée sur Terre d’extraterrestres aurait créé une panique au travers de tous les États Unis… Est-ce vrai ? Est-ce exagéré ? Peu importe. Tout au long de ces années, la science-fiction est tout bonnement en train d’acquérir ses lettres de noblesse qui lui permettront de partir à la conquête des XXème et XXIème siècles.
… à la maturité du genre
Et pourtant, il va encore falloir près d’un siècle pour que la science-fiction acquiert, en France, un statut d’expression artistique à part entière. En effet, au cœur de la deuxième moitié du XXème siècle, la science-fiction restera cantonnée au statut de sous-genre, d’expression populaire, de divertissement pour — éternels — adolescents… Ce snobisme de la culture classique — bourgeoise, mainstream ? — peut être en partie expliquée par la mauvaise compréhension du mot « science-fiction ». En effet, il faut garder à l’esprit son origine américaine. Il faut donc comprendre le terme « Science Fiction » dans son entendement anglais — une fiction dans laquelle les sciences interviennent — où l’épithète précède le déterminant, et non tel que le français l’a abusivement traduit : un récit de sciences fictionnelles.
Une autre raison qui peut expliquer pourquoi la science-fiction restera si longtemps sous considérée en France est que, à compter de la fin des années 30, la majeure partie des œuvres de Sciences Fictions sera produite aux USA. Un autre snobisme français, qui voit dans ces productions un vecteur du soft power américain ? Peut-être… En tout cas, les auteurs français de science-fiction seront « victimes » de cet état de fait : c’est ainsi que, par exemple, à la fin des années cinquante, un Pierre Pairault se choisira un pseudonyme à consonance anglo-saxonne quand il se lancera dans l’écriture de science-fiction : de 1956 à 1959, ses onze romans ont été signés « Stefan Wul ». Ça vous dit quelque chose ? Prenez Oms en série (1957)adapté en dessin animé par René Laloux, sur des dessins de Topor : c’est La planète sauvage (1973)… ou bien L’orphelin de Perdide (1958) qui donnera Les Maîtres du temps (1982), à partir des dessins de Moebius, toujours sous la houlette de René Laloux…
D’autres faits viennent aggraver la réputation de la science-fiction de ce côté-ci de l’Atlantique : toujours avant la Seconde guerre mondiale, elle est principalement diffusée dans les pulp magazines, ces publications populaires américaines, vendues pour quelques cents et imprimées sur du papier de mauvaise qualité, d’où le nom de pulp. Tant et si bien que, ces œuvres, quand elles arrivent en France, elles sont, pour la plupart, traduites à la va-vite. Ce qui n’arrange ni la (mauvaise) réputation ni la perception de ce nouveau genre de ce côté-ci de l’Atlantique. Cette mauvaise règle s’applique indifféremment à ces toutes œuvres, à de rares exceptions près, telles que les traductions (1953 et 1957) de Boris Vian de deux romans de A. E. van Vogt : Le Monde des non-Ā (1945) et Les Joueurs du Ā (1956).
C’est pourtant au cours de cette période, des années 30 jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que des écrivains tels qu’Isaac Asimov, Robert Heinlein ou Arthur C. Clarke, et tant d’autres, vont faire leurs armes d’auteurs de science-fiction, la Seconde Guerre mondiale ne ralentissant en rien la production de ces œuvres. La fin du conflit marque surtout l’entrée dans ce qui est désormais considéré comme l’âge d’or de la science-fiction ou, plus simplement, sa période classique.
Or, cette période doit être observée avec grande attention : en août 1945, les USA font usage de deux bombes atomiques contre le Japon pour en précipiter la capitulation. Cette même année, à Yalta, le monde se trouve divisé en deux blocs, est et ouest, communisme contre libéralisme, qui vont s’opposer jusqu’en 1989, jusqu’à la chute du mur de Berlin. Conséquence de quoi, durant toute cette période, l’humanité va vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de son destin : le risque d’une troisième guerre mondiale qui, cette fois, à n’en pas douter, serait nucléaire. Cette terrible éventualité condamnant l’humanité à subir un hiver nucléaire, en plus des terribles effets secondaires dues aux radiations… Cette angoisse a été matérialisée dans l’Horloge de l’Apocalypse, sur laquelle minuit indique la fin du monde. Depuis 1947, année de création de ce concept, les aiguilles de cette horloge sont déplacées en fonction des tensions, à l’échelle de la planète : au cours des sept dernières décennies, l’heure à l’Horloge de l’Apocalypse n’a cessé d’osciller entre 23 heures 43 et 23 heures 58… Ces tensions ont également produit des œuvres de science-fiction qui en sont la figuration, de manière plus ou moins explicite, dans des formes plus ou moins caricaturales. On peut penser au roman 1984, écrit en 1948 par George Orwell. Il décrit un monde qui sombre dans le totalitarisme, après une troisième guerre mondiale nucléaire qui aurait eu lieu dans les années 50… Vient ensuite Godzilla, le monstre mutant nucléaire japonais né en 1954 du traumatisme issu des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki… Quant à la série Les envahisseurs (The Invaders, 1967), elle peut être interprétée comme une figuration de la peur américaine du communisme : les envahisseurs ne se désintègrent-ils pas en rouge ?
À également lire : Idées | Arborescence simplifiée des thèmes de la Science-Fiction (MàJ du 03/03/21)
Au cœur de ce pessimisme ambiant, la science-fiction n’en reste pas moins inspirée par les avancées technologiques qui s’enchaînent et par les espoirs qu’elles portent en elles : le transistor est mis au point en 1947. Il permet la miniaturisation de l’informatique et ouvre la voie à sa forme moderne. L’acide désoxyribonucléique (ADN) est décrit en 1953, et la vie devient, aux yeux des humains, un livre ouvert… et à modifier. En 1957, la planète lève les yeux vers le ciel au passage du minuscule Spoutnik… et l’appel de l’Espace se répand sur l’ensemble de la Terre. Ainsi, la robotique, la génétique et l’Espace offrent de nouveaux domaines d’imagination et de spéculation aux auteurs. Et la science-fiction se diversifie en sous genres : entre Space Opera, Anticipation, Hard Science, Cyberpunk, Heroic Fantasy, Dystopies, Voyages dans le temps, Uchronies… Chacun de ces genres proposant une facette différente du récit imaginaire, entre grand Espace et grandes aventures, projections probables de l’avenir de l’humanité, récits sous la lame implacable des sciences dures, excursions sur les frontières floues qui séparent réel et virtuel, incursions de la magie dans le réel, récits des meilleurs du pire de l’avenir de l’humanité, voyages temporels et leurs lots de paradoxes et réécritures spéculatives de l’histoire telle que nous la connaissons. Le film de Stanley Kubrik, 2001, l’Odyssée de l’espace (1968), qui est adapté en roman par Arthur C. Clarke, simultanément à la production du film, est le parfait exemple des enthousiasmes et des grandes questions que peut porter la science-fiction. De son côté, Isaac Asimov propose lui aussi un univers loin des dystopies ambiantes avec son histoire de l’avenir de l’humanité qu’il traite en trois grandes périodes et, surtout, au travers du prisme d’une robotique contrainte par ses « lois de la robotique ». Ces périodes sont liées à des personnages forts qui sont le docteur Susan Calvin, « robopsychologue », l’inspecteur de police Elijah Baley et le psychohistorien Hari Seldon. Chacun de ces personnages étant séparés de plusieurs milliers d’années…
On pourrait également citer La guerre éternelle de Joe Haldeman qui se sert de tout ces éléments pour traiter un traumatisme bien américain : le retour au pays des jeunes gens qui ont combattu au Vietnam. Haldeman aurait pu écrire un énième Dear Hunter, Full Metal Jacket ou Rambo… Cependant, en astrophysicien qu’il est, il transpose ses blessures d’ancien combattant dans un avenir proche dans lequel les forces du « Vietcong » sont remplacés par des ET que l’humanité affronte sans jamais les voir…
Et la dystopie étend son règne sur la Science Fiction
Pourtant, en plus de la peur provoquée par la guerre froide, une autre raison de n’envisager principalement que le pire pour l’avenir de l’humanité s’impose au cours de la deuxième moitié du XXème siècle. Il s’agit des risques que les activités industrielles humaines font peser sur l’environnement, que l’on parle de climat ou de biodiversité.
Historiquement, et c’est à noter, la question de l’impact de l’humanité sur son environnement a été évoquée dès 1896. Dans un article paru dans le Philosophical Magazine and Journal of Science, le suèdois Svante Arrhenius, futur prix Nobel de chimie en 1903, alertait ses contemporains des risques de dérèglement climatique, à long terme, liés à de grandes émissions de CO2… Mais, le grand public ne commencera vraiment à entendre parler de ces sujets qu’à partir de 1972, année de publication du rapport Meadows, du Club de Rome. Ce rapport est le premier document, à portée mondiale, qui évoque clairement les dangers que représente, pour l’environnement et donc pour l’humanité, la croissance économique mondiale dans un espace clos, la Terre.
Si le Club de Rome s’est constitué en 1968, les auteurs de science-fiction s’étaient déjà emparés des questions environnementales ne faisant que faire croître la cohorte des œuvres n’envisageant, pour l’humanité, que le pire. On peut ainsi citer Soleil Vert, écrit en 1966 par Harry Harrison. Il décrit une humanité qui a épuisé les ressources de la Terre et qui fait face à des famines globales. Le roman sera adapté au cinéma en 1973, sous le même titre, par Richard Fleischer. Il suit, d’un an, Silent Running de Douglas Trumbull (1972) qui traite de la même problématique : nourrir l’humanité mais, cette fois, d’un point de vue spatial.
Un autre roman doit être, ici, indiqué. Car, à lui seul, et dès 1966, il rassemble et interroge nombre d’enjeux auxquels, aujourd’hui encore, l’humanité doit trouver des réponses. Il s’agit de Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? de Philip K. Dick. Dans ce récit, à Los Angeles, en 2019, on découvre un monde post-industriel et hyper urbanisé (enjeu numéro un) plongé dans une nuit pluvieuse et poisseuse plus ou moins permanente tant le climat est déréglé (enjeu numéro deux). Un monde dans lequel les formes de vie sauvage ont disparu (enjeu numéro trois) et sont remplacées par des êtres vivants issus de la biologie de synthèse. C’est à dire que, désormais, le vivant appartien à l’industriel qui en aura écrit le code génétique (enjeu numéro quatre). Pour s’échapper de cet effondrement global, il ne reste qu’une issue à l’humanité : les colonies spatiales. Mais à quel coût ? Sachant que l’émigration n’est ouverte qu’aux humains exempts de toute tare génétique… Et, là, on glisse vers une forme d’eugénisme (enjeu numéro cinq), et que cette colonisation spatiale est rendue possible par l’usage intensif des réplicants, des êtres humains issus, eux aussi, de la biologie de synthèse. Ces répliquants sont des êtres conscients, mais la reconnaissance de leur humanité leur est refusée (enjeu numéro six). Liste non exhaustive… qui date, rappelons-le de 1966, 13 ans après la découverte de l’ADN, 5 ans après la première orbite de Gagarine autour de la Terre, à bord du vaisseau Vostok 1 et 6 ans avant le rapport Meadows…
À également lire : Ce que « BLADE RUNNER » nous dit sur demain | Huffington Post
Avec Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? qui donnera lieu, en 1982, à une adaptation cinématographique devenue un classique des films de science-fiction, Blade Runner de Ridley Scott, on aborde une dimension du genre qui dépasse de loin le simple divertissement pour éternels adolescents, dimension dans laquelle, cependant, le genre reste toujours confiné. Ce nouveau rôle institue l’auteur de science-fiction en qualité d’artiste à part entière dans sa fonction de « sismographe » de la société, de la culture, de la civilisation dont il est issu. L’écrivain ou le cinéaste, dans leur urgence créatrice, parfois autodestructrice, amène à la connaissance de tous ce que leur sensibilité leur impose. Leurs histoires permettent de mettre des mots, ou des images, sur des enjeux à venir et leurs conséquences à peine perceptibles ou envisageables, dans un monde qui, après la Seconde Guerre mondiale, s’est engouffré dans l’urgence de la reconstruction et ne cesse de découvrir les jouissances de la société de consommation, dans un monde qui ne vit et n’envisage l’avenir qu’à l’aune des échéances et des rythmes électoraux… Sans concession, ces artistes se prêtent au jeu du « Et si… ? Alors… ». Si ce n’est que, eux, tirent les ficelles de la spéculation jusqu’au bout de leurs propres angoisses, de leurs propres folies, plus ou moins entretenues, pour certains, par la consommation de psychotropes qui font leur apparition dans les milieux artistiques après la deuxième moitié du vingtième siècle.
Parce que le monde occidental, principal fossoyeur du climat et de l’environnement, ne veut en rien changer ses modes de production et de consommation, ou même de gouvernance, la science-fiction va s’enfermer dans une vision dystopique de l’avenir de l’humanité. Cet aspect pessimiste — de Cassandre — sera longtemps reproché à la science-fiction et à ses auteurs. Mais, peut-on vraiment leur en vouloir ? Leur rôle l’artiste n’implique-t-il pas d’être honnête dans leur production ?
À également lire : Ce que « STAR WARS VII : LE RÉVEIL DE LA FORCE » nous dit sur demain
Avec la Révolution industrielle, dont, à de nombreuses reprises, il est, ici, question, l’Art est, lui, sorti de la culture, de l’économie de la commande. L’artiste, quitte à être maudit, y a acquis son indépendance. Laissons-le être avare de cette liberté. Surtout qu’il sait être aussi léger : J. R. R. Tolkien, un des grands maîtres de l’Heroic Fantasy — ne serait-ce qu’avec Le seigneur des anneaux, en 1954 — n’a-t-il pas d’abord écrit pour la plus grande joie de ses propres enfants ? Et, George Lucas ? Quel trait de génie, ou de folie, lui a-t-il fallu pour écrire, produire et réaliser Star Wars, ce « remake » des épopées arthuriennes ? D’ailleurs, certains puristes de la science-fiction s’interrogent de la place à donner à Star Wars dans les sous branches de la science-fiction : le cycle de Star Wars appartient-il vraiment au Space Opera ? A moins que ce ne soit plutôt de l’Heroic fantasy tant la place de la Force est importante dans la construction des récits de cet univers qui ne cesse de s’étendre.
De l’ombre à la lumière
Dans les années vingt du XXIème siècle, le statut de la science-fiction a bien changé. La culture dite populaire est de moins en moins dénigrée. Il était temps, plus de cinq décennies après les productions Pop Art d’artistes tels que Roy Lichtenstein ou Andy Warhol.
Désormais, la science-fiction a percolé dans toutes les strates de la création et des médias : née dans les romans, elle a fait des incursions dans le théâtre, a conquis le cinéma et a parfaitement su tirer avantage des médias non linéaires, asynchrones que sont les jeux vidéo. Elle a surtout été rattrapée par la réalité : nombre de ses sujets de prédilection, tels qu’ils ont été effleurés dans ce texte, font désormais partie du quotidien des femmes et des hommes du XXIème siècle : enjeux climatiques, urbains, industriels et technologiques, radicalisation politiques et sociales… Beaucoup d’autres thèmes qui n’étaient abordés que dans une science-fiction qui semblait appartenir à des temps lointains se présentent désormais au seuil de la réalité, du présent : l’intelligence artificielle (l’IA étroite, telle que le monde aujourd’hui la pratique, va néanmoins vite avoir des implications, ne serait-ce que dans le monde du travail et bien que l’on reste loin de l’intelligence artificielle généraliste, consciente et autonome souvent fantasmée), la robotique (la question de la capacité d’empathie de l’humain à l’égard d’un être artificiel interroge la future place des robots dans la société de demain), le génie génétique, qu’il soit curatif ou qu’il dérive vers le confort (la découverte des « ciseaux » génétiques CRIPR/CAS9 porte autant d’espoirs pour les malades que de risques de dérives — eugénisme, chimères…), l’exploration et l’exploitation des domaines spatiaux (peu importe que les entrepreneurs milliardaires du New Space — Elon Musk et Jeff Bezos en tête — soient fous ou visionnaires : ils ont les moyens de leurs ambitions et d’autres acteurs, d’autres nations se préparent à les rejoindre, à les challenger). Donc tout s’accélère…
On peut aussi aborder les thèmes et des enjeux écologiques, qui ont mal à s’imposer comme courant de pensée transversal à toutes politiques territoriales ou globales. Cependant, l’écologie se découvre un étonnant allier dans la collapsologie, courant de pensée qui, lui, étudie les risques d’effondrement civilisationnel à l’échelle de l’humanité et qui produit des œuvres étonnantes de noirceur et de créativité comme, par exemple La route de Cormac McCarthy (2006).
Face à l’urgence que représentent les enjeux climatiques et face à l’inertie des sociétés humaines modernes désormais planétaires, cette même écologie se met à produire des concepts dignes des œuvres de science-fiction les plus ambitieuses : c’est par exemple L’Hypothèse Gaïa (1970), de James Lovelock, qui invite l’humanité à concevoir la planète Terre, tous les biotopes qu’elle contient et toutes les formes de vie qui s’y épanouissent, comme un unique et vaste superorganisme. Le choix du nom Gaïa n’est pas neutre : elle appartient au panthéon grecque. Gaïa est surtout associée à la déesse mère primordiale. C’est ainsi que l’hypothèse Gaïa injecte dans des sociétés occidentales, qui pourtant se revendiquent athées, des réminiscences de panthéismes antiques et un retour en force des mythologies qui s’avèrent persistantes bien qu’elles prennent de nouvelles formes : les zombies ne seraient-ils pas une expression moderne de la dualité Eros/Thanatos ?
Une créativité qui dépasse le divertissement
La science-fiction, de son côté, continue son œuvre de créativité : comme Janus, le dieu romain, elle présente un visage tourné vers hier et un autre vers demain. Le visage tourné vers hier invite le présent à se plonger dans un corpus d’œuvres de science-fiction qui s’étend désormais sur plus de deux siècles, à partir de 1818 si l’on prend le roman épistolaire de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, comme pierre baptismale de la science-fiction, ou 1790 si on confie cette tâche au Miroir des événements actuels ou la Belle au plus offrant, Histoire à deux visages de François-Félix Nogaret. En tout cas, ces œuvres qui s’égrainent au fil du temps nous renseignent autant sur les angoisses que sur les espérances des époques qui les ont produites. Elles sont des marqueurs temporels qui nous permettent de voir, depuis notre temps présent, comment ces époques, ces sociétés se sont saisies ou non de ce qui étaient les enjeux de ces temps révolus : l’entrée dans la modernité (en remplaçant le principe magique par le phénomène physique), les impacts de l’industrialisation et de l’innovation (sa fille plus ou moins légitime), sur la construction des sociétés humaines, que l’on soit optimiste ou non, les enjeux sociaux et politiques qui ne seront jamais effacés par l’enthousiasme technocentré, les enjeux climatiques et la prise de conscience de l’impact des activités humaines sur l’écosystème planétaire, les émergences et les nouvelles altérités…
Ce corpus d’œuvre peut aussi permettre de porter un regard critique sur les événements du présent qui peuvent nous dérouter. En 2016, à tort ou à raison, n’a-t-on pas exhumé, aux USA, les romans 1984 de George Orwell et La servante écarlate de Margaret Atwood (1985) pour tenter de donner un sens à l’élection de Donald Trump ? De leur côté, des romans ou des films tels que Ravage de René Barjavel (1943), Je suis une légende de Richard Matheson (1954, adapté au cinéma par Francis Lawrence, en 2007), Contagion de Steven Soderbergh (2011) ou World War Z de Marc Forster (2013) n’auraient-ils pas quelque chose à dire de l’actuelle crise sanitaire que la planète est en train de vivre et de sa gestion par les gouvernements de la planète ? Quelles seront les conséquences de cette pandémie, conséquences sociales, économiques, en termes de confiance et/ou de défiance à l’égard des gouvernants et des « sachants » ?
Le deuxième visage de la science-fiction, tourné vers le futur, interroge toujours et encore l’avenir de l’humanité, ses choix, ses actions et leurs conséquences. Cette science-fiction qui est en train d’être écrite permet à tout un chacun de s’intéresser à des questions qui parfois sont de l’ordre du signal faible (à peine audible), du cygne noir, que l’on se refuse à envisager (concept philosophique qui fait référence aux cygnes qui, jusqu’à la toute fin du XVIIème siècle, n’étaient envisagés que blanc, avec toute la symbolique qui va avec, jusqu’à ce que des explorateurs découvrent des cygnes noirs, en Australie…), ou de l’ordre de la confiscation, quand une idée est soustraite à la discussion libre et publique.
Cette dernière mention fait, entre autres, référence aux Transhumanistes. Avec leur enthousiasme et leurs moyens — ils ont avec eux l’Université de la Singularité, financée par Google, Nokia, Autodesk, IDEO Genentech et autres Linkedin — ils se sont appropriés les questions éthiques que suscitent l’utilisation des technologies sur le corps humain, en prônant unilatéralement l’Humain augmenté et en annonçant la mort de la mort comme but ultime… Suscitant rejet ou adhésion, de manière plutôt manichéenne, les Transhumanistes empêchent surtout la société civile de s’approprier des questions, des interrogations, des doutes et des espoirs qui doivent être débattus, aujourd’hui, avant que, sous peu, ils n’adviennent. Or, les œuvres de science-fiction permettent cette réappropriation.
Indépendamment de l’actuelle crise sanitaire qui oblige les chaînes de télévision à piller des catalogues parfois éculés, tant elles sont en manque de programmes « frais », le récent vernis de respectabilité acquis par la science-fiction permet de voir diffusés, sur des grands réseaux (chaînes de télévision ou services de vidéo à la demande) nombre de films qui étaient, il y a peu encore, confidentiels. On peut citer, ici, l’excellent Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol (1997) qui fait des va-et-vient entre services de VÀD et chaînes de télé, ou bien encore Enemy Mine de Wolfgang Petersen (1985), récemment diffusé sur Arte. Qui, un jour, ayant vu ce film, plus ou moins honteusement, aurait imaginé le voir diffusé sur ce média élitiste s’il en est ?
À également lire : Analyses prospectives de films de science-fiction
Les services de vidéo à la demande ont parfaitement compris que dans la science-fiction recelait un filon. D’ailleurs, les adaptations de romans et les créations originales s’enchaînent sur tous les réseaux : c’est la série The Expanse (adaptée du roman de James S. A. Corey) qui, en cinq saisons toujours renouvelées sur Amazon Prime, raconte une humanité qui s’est répandue dans le système solaire… plus récemment, c’est la série de Ridley Scott, Raised by Wolves, sur HBO Max, qui relate un « reboot » de l’humanité, quand le dernier film de George Clooney, Minuit dans l’univers (adapté du roman Good Morning, Midnight de Lily Brooks-Dalton), sur Netflix, se frotte à l’Apocalypse pour Noël 2020… en 2021, la série Fondation (adaptée du cycle Fondation d’Isaac Asimov), sur Apple TV, projettera l’humanité dans un avenir millénaire à l’échelle galactique… la liste est sans fin… Tout comme les univers spéculatifs.
Il ne faut cependant pas se laisser duper par cette bienveillance opportuniste des marchés et des médias à l’égard de la science-fiction. Car, en définitive, il se pourrait bien que la science-fiction d’une époque donnée, jugée par certains irrationnelle, peu importe qu’ils aient raison ou non, permette aux femmes et aux hommes de ce temps de se confronter, au travers d’une œuvre, donc sur le mode du divertissement, à des enjeux rationnels, accessibles à plus ou moins long terme dont, irrationnellement, ils ne veulent pas se saisir, dont ils ne veulent pas entendre parler ! C’est ainsi que, en pleine dystopie désormais endémique — pandémie, crises économiques, crises climatiques, prises de paroles tonitruantes des populistes, défiance croissante à l’égard des institutions démocratiques — la science-fiction continue à proposer des œuvres toujours plus étonnantes et, en ce XXIème siècle désormais bien entamé, des œuvres se révèlent finalement teintés d’une forme d’optimisme… et cela à l’encontre des collapsologues et des rationnels de tous poils.
Traçant son sillon, comme elle le fit au cours des deux derniers siècles, la science-fiction se nourrit des espoirs portés par des individus, visibles ou non… elle s’abreuve à la fraîcheur d’entrepreneurs enthousiastes, que l’on parle des domaines sociaux, économiques, territoriaux, environnementaux ou artistiques… elle s’appuie sur des générations montantes qui agissent, à leur échelle, conscientes des transformations qu’elles doivent accomplir en elles afin de construire un futur souhaitable… sur des générations qui ne baissent pas les bras, pour elles-mêmes et surtout pour les générations qui viennent… tout cela alors même que les indicateurs rationnels annoncent de sombres horizons.
C’est dans ce contexte complexe et angoissant que des auteurs de science-fiction, des artistes, des plasticiens, des urbanistes — à coup sûr irrationnels — créent un nouveau genre de science-fiction, une réponse positive aux signaux ténus qu’ils perçoivent de part le monde, eux, les « sismographes » de nos mondes modernes et un peu fous. Ce nouveau genre s’appelle le Solarpunk. Ce genre est encore à l’état embryonnaire, mais en lui, il y a le germe de l’espoir irrationnel que tout n’est pas figé, que l’avenir reste à être écrit à l’encre des actions rationnelles ou non des femmes et des hommes de notre temps et des temps qui viennent. Ce nouveau sous genre rappelle aussi qu’il n’y a pas de valeur morale dans la technologie mais bien dans l’intention qui préside à son utilisation.
Alors, que vous soyez néophyte ou expert en matière de science-fiction, que vous vous sentiez plus à l’aise dans le Space Opera ou que vous vibriez aux sombres horizons de la dystopie, que vous trépigniez d’impatience de découvrir le Solarpunk ou que tous ces mots et ces soi-disant genres demeurent pour vous charabia, permettez-moi de vous souhaiter à un beau voyage en terre de science-fiction, domaine de l’irrationnel rationnel !
Extrait du livre collectif des Mardis du Luxembourg : L’Horrificque Disputatio à acheter dans la boutique de FuturHebdo/Le Comptoir Prospectiviste
© Olivier Parent
Les chroniques Cinéma de FuturHebdo :
– Ce que « ANIARA » (2018) nous dit sur demain | Space’ibles 2020 ;
– Ce que « GEOSTORM » (2017) nous dit sur demain | Space’ibles 2020 ;
– Ce que « PROXIMA » nous dit sur demain | Huffington Post
– Ce que « OUTLAND » nous dit sur demain | Space’ibles 2019
– Ce que « TERMINATOR : DARK FATE » nous dit sur demain | Huffington Post
– Ce que « AD ASTRA » nous dit sur demain | Huffington Post
– Ce que « ELYSIUM » nous dit sur demain | Space’ibles 2018
– Ce que « MOON » nous dit sur demain | Space’ibles 2018
– Ce que « ALITA BATTLE ANGEL » nous dit sur demain | Huffington Post
– Ce que « READY PLAYER ONE » nous dit sur demain | Huffington Post
– Ce que « BLACK MIRROR (S04) » nous dit sur demain | Huffington Post
– Ce que « BLADE RUNNER 2049 » nous dit sur demain | Huffington Post
– Ce que « LES FILS DE L’HOMME » nous dit sur demain
– Ce que « PASSENGERS » nous dit sur demain | Space’ibles 2017
– Ce que « 2075, LES TEMPS CHANGENT » nous dit sur demain | Space’ibles 2017
– Ce que « BLADE RUNNER » nous dit sur demain
– Ce que « VALERIAN : LA CITE DES 1000 PLANETES » nous dit sur demain | Huffington Post
– Ce que « LIFE : ORIGINE INCONNUE » nous dit sur demain | Huffington Post
– Ce que « GHOST IN THE SHELL » nous dit sur demain | Huffington Post
– Ce que « MORGANE » nous dit sur demain | Huffington Post
– Ce que « HARDCORE HENRY » nous dit sur demain | Huffington Post
– Ce que « DIVERGENTE 3 : AU-DELÀ DU MUR » nous dit sur demain | Huffington Post
– Ce que « STAR WARS VII : LE RÉVEIL DE LA FORCE » nous dit sur demain | Huffington Post
– Ce que « BIENVENUE A GATTACA » nous dit sur demain
– Ce que « SEUL SUR MARS » nous dit sur demain | Huffington Post
– Ce que « CHAPPIE » nous dit sur demain
– Ce que « INTERSTELLAR » nous dit sur demain
– Ce que « RETOUR VERS LE FUTUR 2 » nous dit sur demain
– Ce que « ROBOT AND FRANK » nous dit sur demain
– Ce que « REPO MEN » nous dit sur demain
– Ce que « RENAISSANCES » nous dit sur demain
– Ce que « MINORITY REPORT » nous dit sur demain

















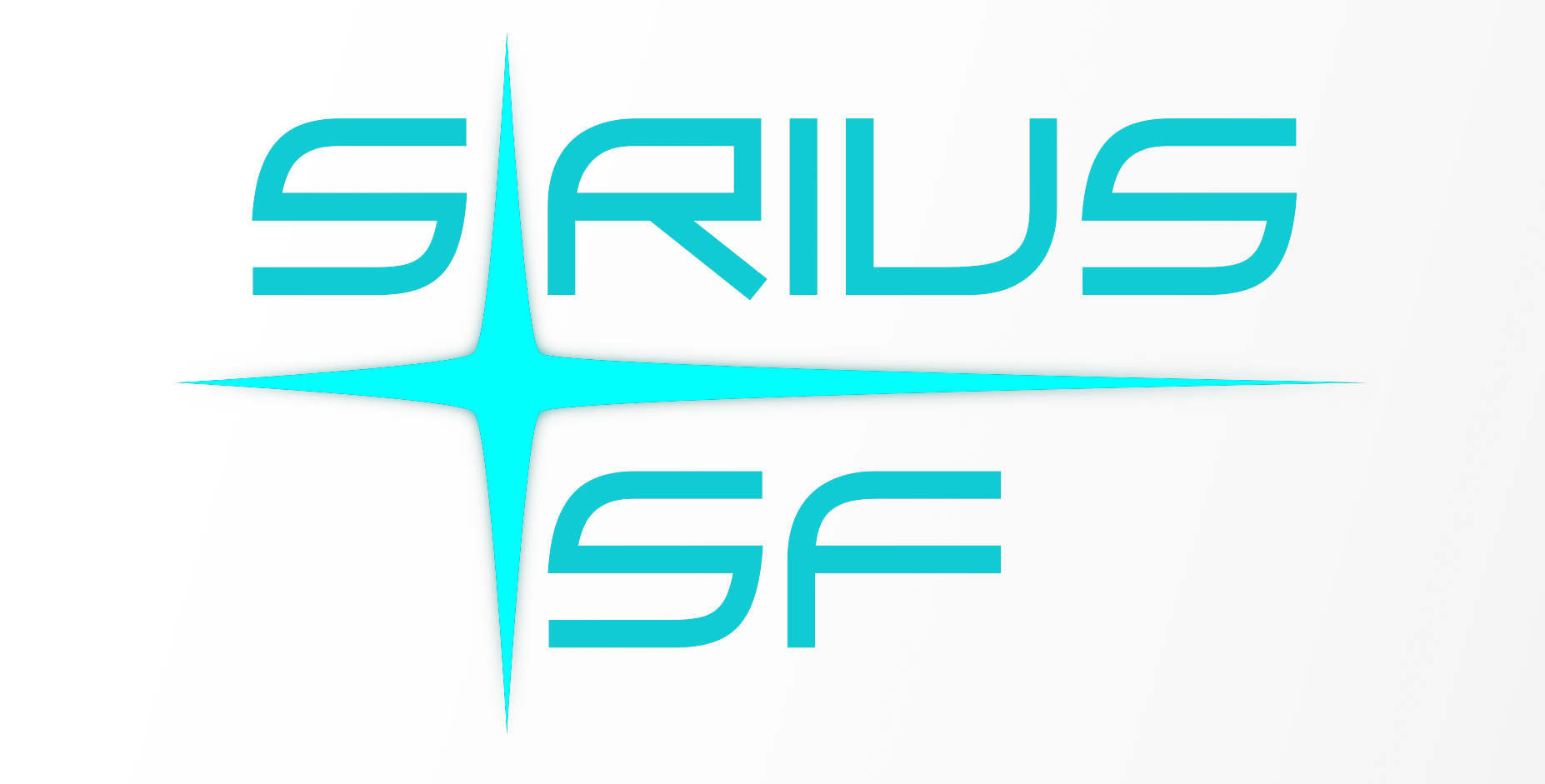

Comments are closed.