Thomas Michaud est un auteur prolifique et inspirant. L’imaginaire science-fictionnel n’a pas de secret pour lui. Ses contributions balaient large, de la théorie à la pratique. Il a publié trois romans de SF et de nombreux textes théoriques. Autant d’excellentes raisons qui font de lui un compagnon de route de FUTURHEBDO depuis des années. Ma bibliothèque personnelle en témoigne. Son livre de 2008 a accompagné la rédaction de mes Mythologies du futur de 2014. Les post-it à de nombreuses pages en témoignent. Sans compter ceux qui sont logés dans mon Kindle. Son nouveau livre – FUTUROTYPES – prolonge ses explorations.
par Christian Gatard
Un futurotype, explique-t-il, est un « prototype diégétique ». Ce qui mérite une petite explication. Il s’agit d’un récit (en grec ancien διήγησις (diēgēsis), signifiant littéralement « narration » ou « récit ») ancré dans un monde fictif et qui a pour vocation de stimuler une interrogation prospective sur des futurs proposés. Si les uns sont redoutés, l’idée est de préparer un contre-poison. Si d’autres sont souhaités, il s’agira de voir comme les faire émerger, les accélérer, les optimiser.
Les futurotypes imaginés par Michaud sont – nous dit-il – des archétypes. On sait (et on aime bien l’idée) que pour Jung l’archétype est une strate de la psyché humaine commune à tous les êtres humains, hérités biologiquement et culturellement à travers l’histoire de l’humanité. Michaud évoque plutôt l’idée que ses futurotypes sont des inventions simulant une réalité potentielle destinée à stimuler l’imaginaire. Autrement dit ses archétypes (alias futurotypes) sont des exercices de pensée renouvelant les stocks ancestraux de l’imaginaire humain. Avec une vocation revendiquée de pousser à développer des histoires à vocation performative – c’est-à-dire à transformer le réel. Ce qui ne contredit pas Jung…
Une approche créative délicieusement décalée de la prospective
Avant de tenter une analyse des propositions de Michaud, un mot sur son approche créative.
A la différence de ses romans – et en l’occurrence de la démarche canonique de la SF – Michaud ne prétend pas ici à une « suspension de l’incrédulité » qui consiste pour le lecteur à accepter temporairement les éléments fantastiques, invraisemblables ou irréalistes présentés dans une œuvre, afin de pleinement apprécier l’expérience narrative proposée. Les clins d’œil malicieux sur les noms des protagonistes convoqués dans ces futurotypes relèvent d’une onomastique ingénieuse. Baptiser un cardinal Paul Hisse et son cousin John Hisse dans le texte sur l’origine de l’imagination attribuée à Dieu souligne le parti pris : il ne s’agit pas de prendre au sérieux le prototype diégétique – le scenario ne va pas advenir – mais de rappeler que sa quarantaine de futurotypes sont des exercices de pensée. Ils sont destinés à caractériser une situation précise dans un futur à temporalité variable. Les hypothèses sont plus ou moins dystopiques, les récits plus ou moins facétieux. A chaque fois il s’agit de se dire : et si un truc de ce genre finissait par surgir ?
Certaines de ses visions sont vertigineuses, d’autres à courte focale. Toutes interpellantes. Le lecteur est baladé dans des futurs perçus , les uns comme probable (ce qui n’évite pas leur incongruité comme cette épidémie de diarrhées mondiales et mortelles – la Cuvide (cul – vide, il faut oser !), d’autres comme résolument tabou comme un génocide européen qui n’a rien à envier à ceux qui baignèrent de sang le 20ème siècle. Le prolongement des courbes de notre actualité au 21ème est souvent convaincant. L’évolution des potentiels dictatoriaux de la neuroconnexion fait froid dans le dos. Le retour du latin pour remplacer l’anglais international est plutôt excitant. Le business du tatouage vidéo l’est peut-être un peu moins. La preuve de l’existence de Dieu est hilarante, les chasses virtuelles sont très tentantes… Mais pas de divulgâche ! On s’amuse trop dans ce cabinet de curiosités du futur.
Un enjeu stratégique
Si l’approche est ludique, l’enjeu est stratégique. Michaud l’annonce dans son introduction : les futurs qu’il imagine sont en embuscade, ils peuvent nous tomber dessus à tout moment, nous prendre à contre-pied. Si aucun ne va sans doute s’incarner exactement comme il les imagine, ils sont là pour nous inciter à nous tenir sur nos gardes. Et donc éventuellement à chercher la parade. Peut-être la trouver.
Quels sont les points d’inflexion que Michaud pressent pour l’avenir et les alertes qu’il nous propose ?
Explorons ses hypothèses (qui ne sont pas nécessairement ses convictions mais, encore une fois, des exercices de pensée)…
Le fil d’Ariane est l’omniprésence de la technologie. Elle va reconfigurer les sociétés humaines sur terre ou ailleurs. Les structures familiales, éducatives et professionnelles vont être bousculées sinon bouleversées. Les capacités humaines vont être augmentées mais aussi conditionnées, entraînant potentiellement une diminution de l’autonomie individuelle et une redéfinition du sens de l’identité personnelle. Une modification radicale de la gouvernance est inéluctable avec d’une part, une technocratie algorithmique potentiellement déshumanisée, de l’autre, des entreprises privées et des individus influents qui acquièrent une autorité quasi souveraine.
Michaud décrit un avenir en tension. La technologie qui vient sera radicale, englobante, surplombante. Autant d’adjectifs qui pourraient paraitre inquiétants ? Peut-être. Question de verre à moitié vide, à moitié plein. Cela a sans doute toujours été le cas. L’inventeur de l’arc et des flèches a probablement été accusé d’être dangereusement téméraire et de mettre en danger le climat de son temps. Et le pire c’est que ce fut peut-être le cas. De la flèche aux ogives nucléaires ? Mais il fallait bien chasser pour survivre.
Face à cette technologie galopante la société humaine a toujours eu une capacité plus ou moins réactive à s’y adapter. S’adapter au pire ? L’impensable du matin devient acceptable en fin d’après-midi. La fenêtre d’Overton a encore frappé.
Certains de ces futurotypes décrivent un avenir plutôt sombre. Pas tous. Il faut explorer cette caverne d’Ali-Baba des futurs. L’humour (parcimonieux mais récurrent) de Michaud y est peut-être la politesse de son désespoir ? Je suis injuste. Il s’en sort souvent par des pirouettes sympathiques.
Les futurotypes comme catalyseurs d’expériences de pensées
En définitive, les futurotypes de Michaud ne sont pas des oracles, mais des catalyseurs. Ils ne nous disent pas ce qui sera, mais ce que nous pourrions choisir de devenir. Leur valeur n’est pas dans la prédiction, mais dans la friction intellectuelle qu’ils suscitent – cette capacité à déranger l’évidence, à renverser les évidences, à activer notre lucidité. Sous leurs airs de fictions légères ou de clin d’œil onomastiques, ils sont en vérité des laboratoires poétiques de vigilance. Michaud, en artisan des futurs imaginaires, ne cherche pas tant à nous effrayer qu’à nous outiller : par l’humour, la mise à distance, la charge symbolique et l’invention narrative, il nous aide à construire des anticorps cognitifs pour affronter les virus du réel.
Cette œuvre s’inscrit dans une lignée de pensée où la spéculation devient une forme d’éthique : penser des futurs improbables, c’est refuser la résignation à une seule voie, c’est rouvrir l’éventail des possibles, c’est politiser notre imagination.
L’auteur comme compagnon de route
Thomas Michaud confirme la démarche que promeut FuturHebdo depuis sa création. Il en est d’ailleurs, on l’ a dit, un fidèle compagnon de route. Les futurotypes sont des germoirs d’autonomie, des matrices de désobéissance douce, des machines à réenchanter l’agir. Ils nous rappellent, au fond, que dans la grande histoire du vivant, l’espèce humaine n’a jamais survécu par la force, mais par la ruse, la coopération et la capacité à raconter de nouvelles histoires quand les anciennes ne suffisaient plus.
Et si la technologie devenait le théâtre de notre propre ruse, non plus un dispositif de soumission mais une scène d’insurrection poétique ? Michaud ne nous offre pas des réponses, mais des aiguillons. À nous d’en faire des tremplins. Car dans la fabrique du futur, l’imagination n’est pas une échappatoire : c’est un chantier stratégique.

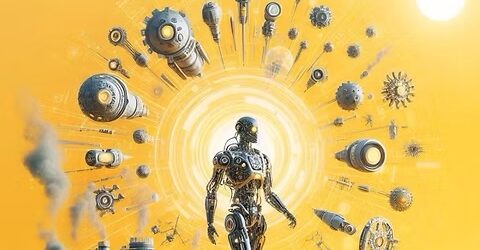












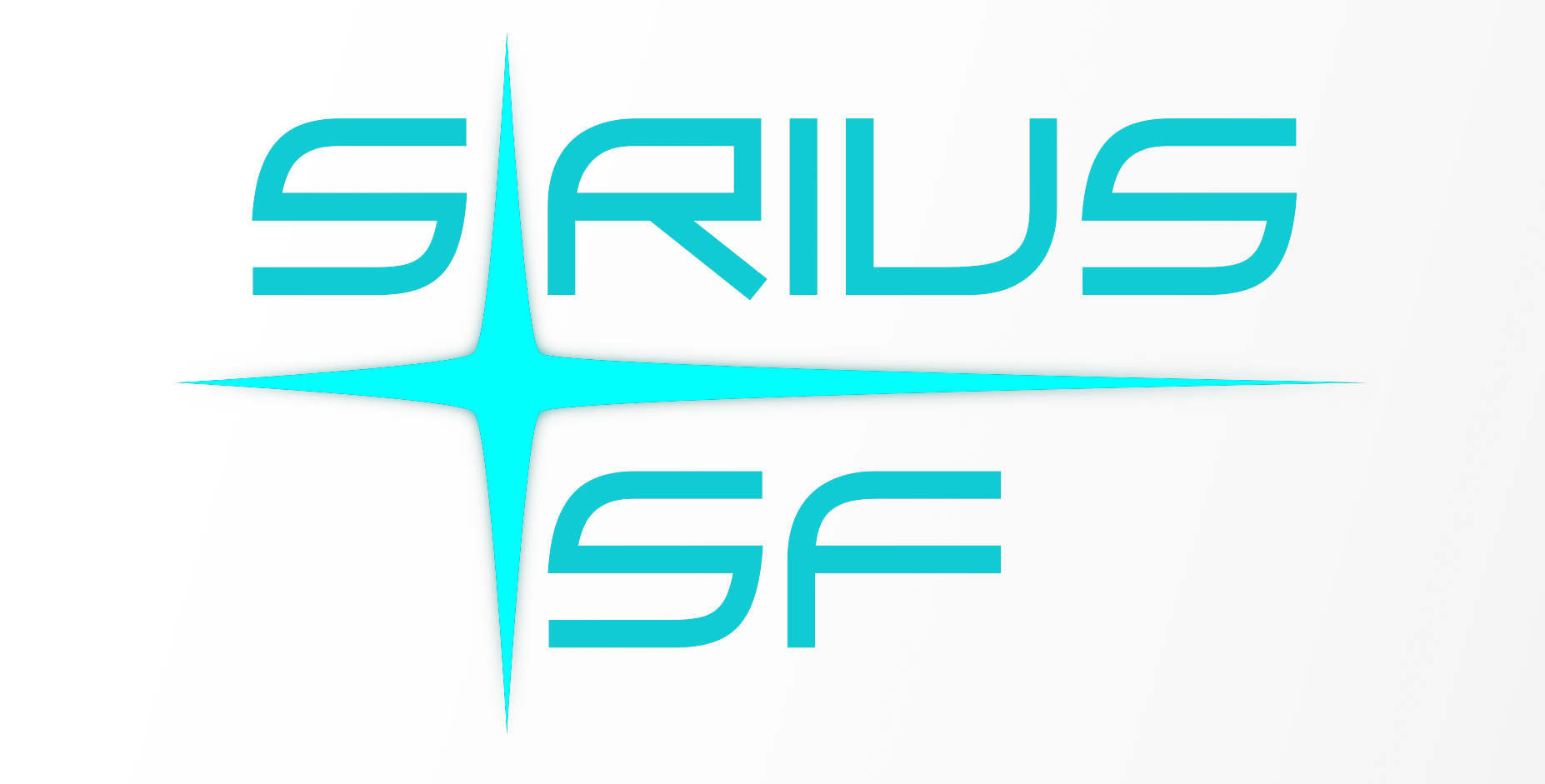

Comments are closed.